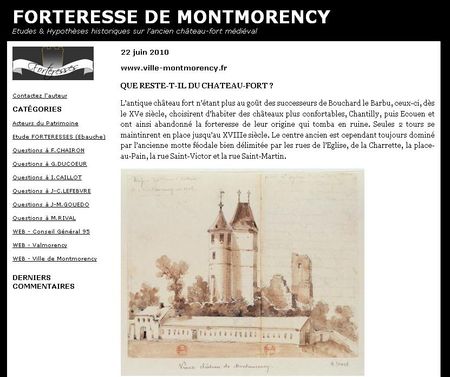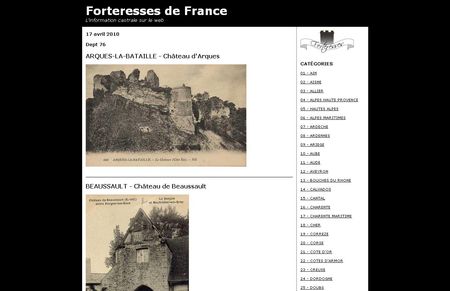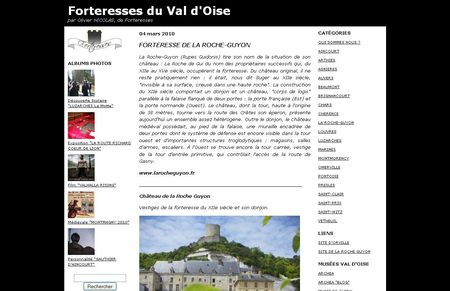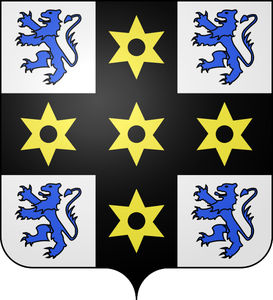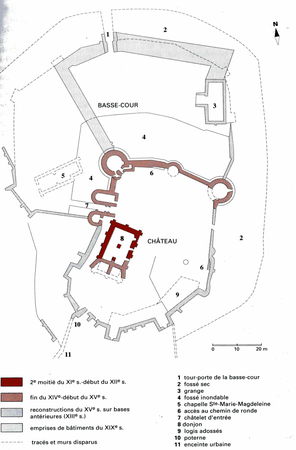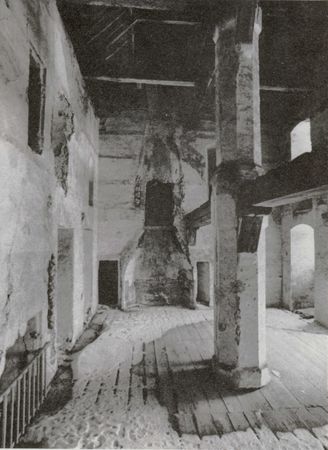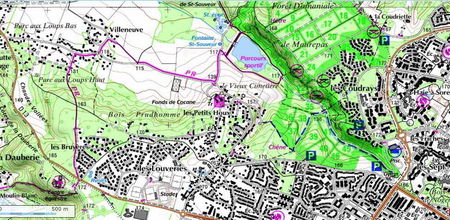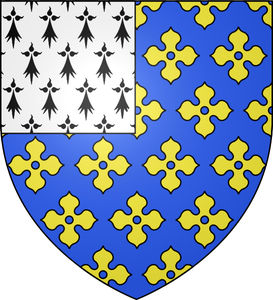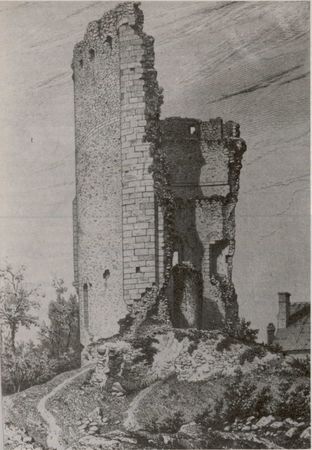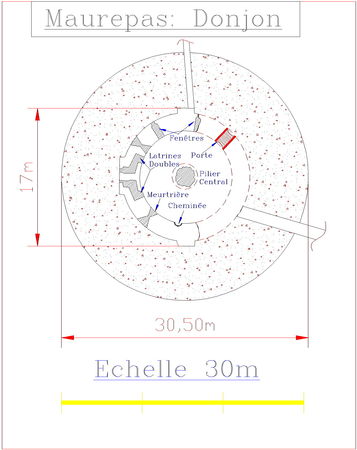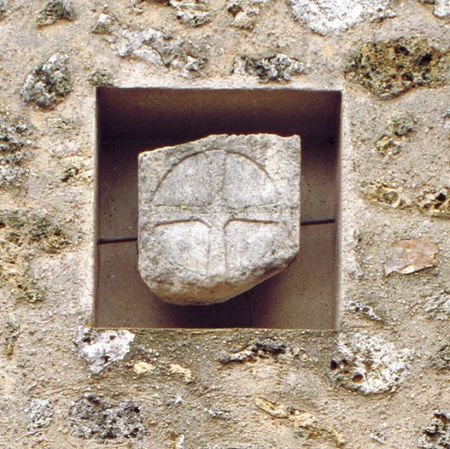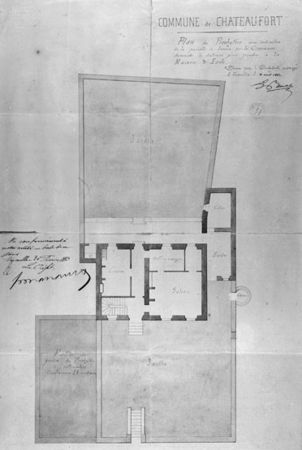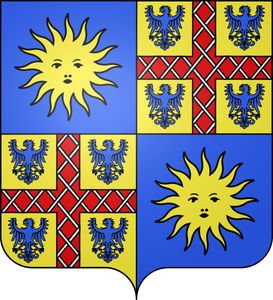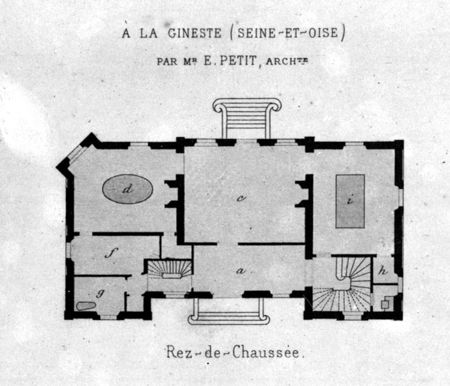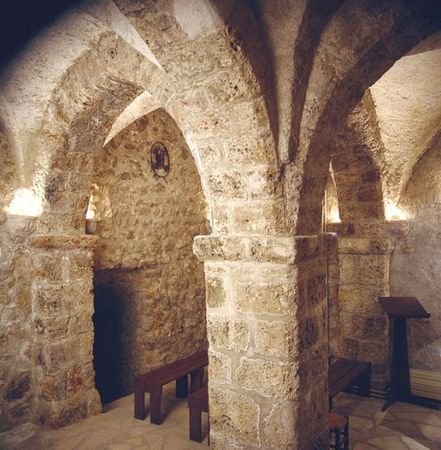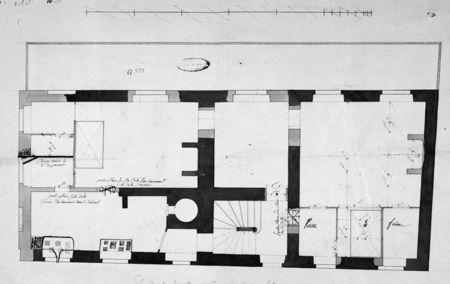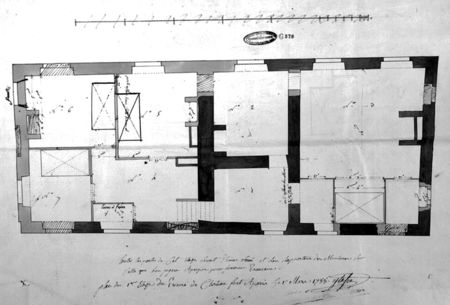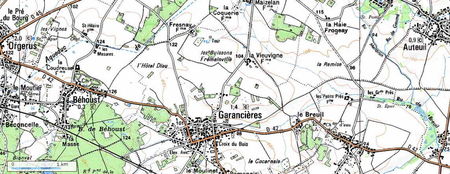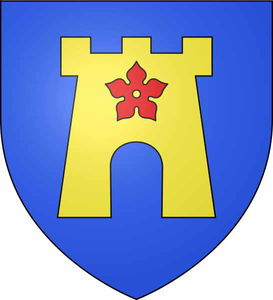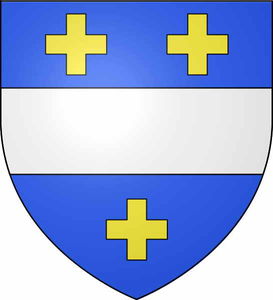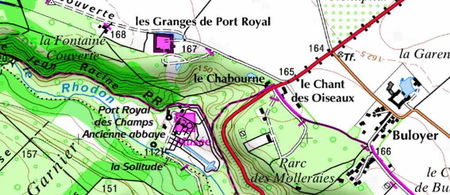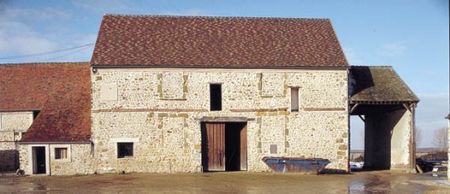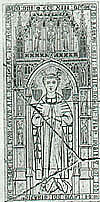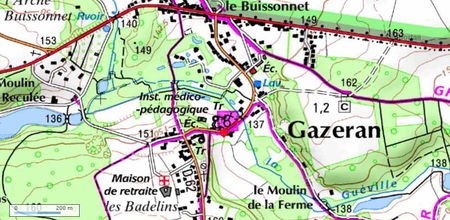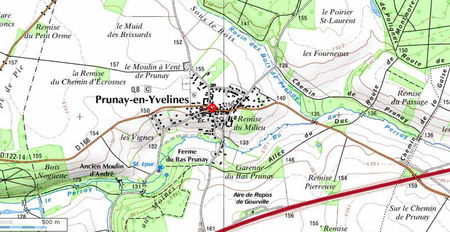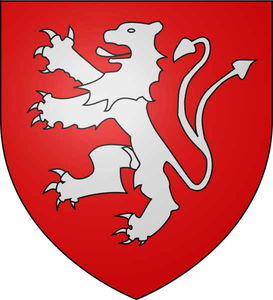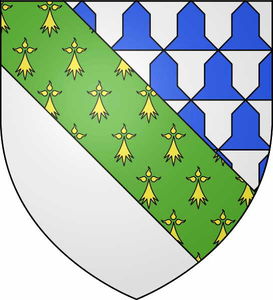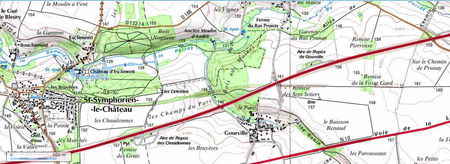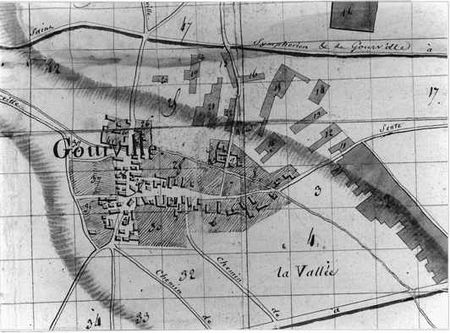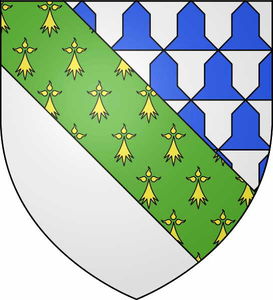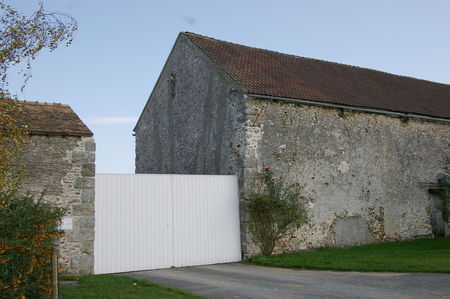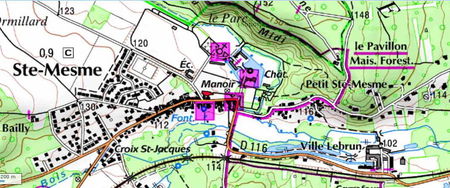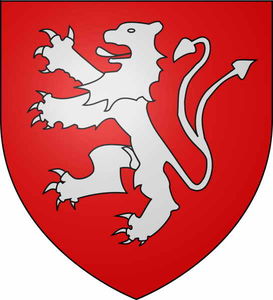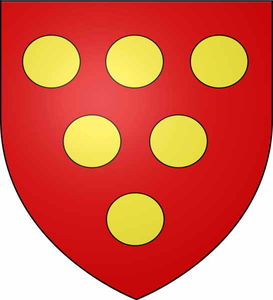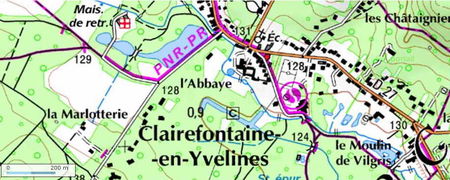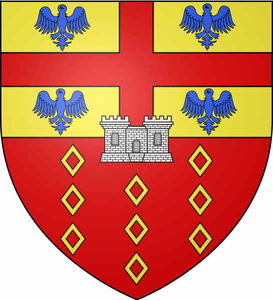Luzarches
Asnières-sur-Oise
7.Index et bibliographie: - Châteaux forts et
7.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
Débat : Vos avis et sentiments nous intéressent
Débat :
Vos avis et sentiments nous intéressent !!! Soutenez-nous dans notre action de préservation du patrimoine médiéval "castral".
Découvrez les informations récentes en cliquant sur la photo suivante :
Des travaux d'aménagement et des fouilles préventives, conduites par l'organisme agréé EVEHA (délégation DRAC / SRA) sont actuellement en cours sur le site de l'ancienne forteresse de Montmorency (95, Val d'Oise).
Sur l'emplacement de l'ancien donjon roman (Tour Trompette dans les textes), des aménagements sont prévus. Il se pourrait que certaines structures médiévales non-protégées puissent être touchées... quand les pouvoirs en place nous assurent le contraire...
Les travaux commencent début Juillet 2010.
Petit aperçu des différents travaux de
Petit aperçu des différents travaux de l'association :
Conception : Franck FAUPIN & Olivier NICOLAS
__________________________________________________
Site Internet (en construction)

__________________________________________________
Recensement Forteresses de France
__________________________________________________
Forteresses de Basse-Normandie
__________________________________________________
Forteresses de Bretagne
__________________________________________________
Forteresses du Val d'Oise
__________________________________________________
Samedi 10 Avril 2010 Visite Guidée Costumée
Samedi 10 Avril 2010
Visite Guidée Costumée exclusive :
"Sur les traces des Comtes de Beaumont, Grands Chambriers de France"
Itinéraire d'Asnières-sur-Oise à Beaumont-sur-Oise
Tarif : 6€ / personne, gratuit pour les adhérents à l'association FORTERESSES
Au programme :
10H30
Découverte de la Motte castrale d'Asnières-sur-Oise
commentée par Mr Olivier NICOLAS, de l'association FORTERESSES
Rendez-vous à 10h-10h15, sur le parking de l'église d'Asnières
12H00
Déjeuner sur le site de la Motte de la Forêt de Carnelle
Prévoir un pique-nique
14H00
Découverte du Château de Beaumont-sur-Oise
commentée par Mr Christophe TOUPET,
Archéologue du Département et Conservateur en Chef du Patrimoine
Rendez-vous vers 13h45 place du Château
Chevreuse, l'apogée des donjons romans barlongues,
CHEVREUSE
Ou l'apogée des donjons romans barlongues
La région entre Montfort et Rochefort tome VI
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La ville de Chevreuse se situe à la limite du département de l'Essonne, dans la vallée de Chevreuse, sur les bords de l'Yvette, juste avant la confluence avec le Rhodon, à 28 km au Sud-Ouest de Paris. Le territoire communal est inclus dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, dont Chevreuse héberge le siège. Chevreuse est la dernière commune de la vallée à être incluse dans l'unité urbaine de Paris, en allant vers l'Ouest. Le centre ville, édifié dans le bas de la vallée, est surmonté sur son flanc nord par le château de la Madeleine. L'Yvette est la principale rivière de Chevreuse. Elle traverse la ville d'ouest en est. Elle prend sa source à Lévy Saint Nom et se jette dans l'Orge à Epinay sur Orge.
Le nom de « Chevreuse » évoque un pays de chèvres ou de chevreuils. Le village est mentionné dès 980 dans une bulle du pape, sous le nom de Cavrosa. Nommée en 1228, Caprosia Dista Quisa Caprosa à cause de la quantité de chèvre qu'il y avait en ce lieu d'après l'appendice de Guillaume de Nangis. Au moyen âge, c'était un bourg de la prévôté et de la vicomté de Paris avec titre de Baronnie, seigneurie possédée par une branche de la maison de Montmorency. Vers l'an Mil, les terres de Chevreuse et de Montlhery sont inféodées par l'évêque de Paris à Thibaud File Etoupe, ce presonnage est à l'origine d'une dynastie de seigneurs indociles, qui ont dominé jusqu'au début du XIIs le Sud de l'Ile de France, par la possession des seigneuries de Montlhéry, Rochefort et Chevreuse. L'histoire de Chevreuse remonte sous le règne de Robert le Pieux, c'est à cette époque que les sires de Montlhéry se construisirent une formidable résidence sur le plateau de la madeleine qui domine de 90m la plaine actuelle de Chevreuse. Les premières traces écrites du château sont de 1024 par Millon Ier sire de Chevreuse, mort lors de la première croisade. Cette première mention n’indique cependant pas que la place n’était pas plus ancienne, mais c’est la seule trace existante irréfutable. Il existe notamment un certain Thibault File-Etoupe juste avant Millon Ier, mais sans aucune exactitude. Le château à cette époque n’existait pas, au mieux il y avait une batisse renforcé pour éviter les attaques de brigands, mais encore là peu d’exactitude. Sa construction a commencé entre 1030 et 1090. Elle a été commandée par Gui Ier, seigneur de Chevreuse. Il s'agissait de défendre la ville de Chevreuse, victime de pillages. Vers 1075, Gui Ier construit le premier Donjon il faut dire que l’emplacement est stratégique : il surplombe une bonne partie de la vallée de l’Yvette et possède plusieurs cours d’eau (appelé ru ) élément très important pour l’époque. La vallée faisait la jonction entre la Normandie et la France et permettait notamment le passage entre la vallée de la Seine et celle de la Loire, dont notamment en direction de Chartres. L’aspect résidentiel et de défense ressemble peu à ce que nous pouvons voir aujourd’hui, même si le donjon actuel reprend quelques formes, mais relativement quand même bien éloigné. Le donjon de cette époque avait une particularité plutôt futée : au lieu d’avoir une entrée au rez-de-chaussée, l’entrée principale se faisait au premier étage accessible avec une échelle et/ou un escalier de bois, permettant de surplomber et de résister à un siège. Au XIe siècle, le donjon n'était sans doute entouré que d'une palissade en bois qui ne fut remplacée par des murailles de pierre qu'au XIIe siècle. En 1108, Louis VI le Gros, assiège le château, mais ne réussira pas à l’envahir. En 1120, construction de l’Aula castrale qui est une sorte de grande maison seigneuriale composé d’un étage et d’une ou plusieurs grandes salles où les seigneurs vivaient et surtout profitait d’une vie souvent bien arrosée (elle comportait la salle de reception et les chambres), elle disparaîtra vers le XVe siècle. En 1140 sous le règne de Milon III, une partie de la forêt avoisinante du château est coupée pour permettre l’extension et d’assurer une plus grande défense. On est dans une époque où les moyens guerriers tant en défense qu’en attaque se développent ardemment. Milon III fut l'ambassadeur de Louis VII auprès de l'empereur de Constantinople en 1146 et mourut en 1150. En 1192 Gui III de Chevreuse rentrent avec Philippe Auguste de la croisade et fait des dons à la maison templière de la Villedieu de Maurepas. Son fils Gui IV fut retenu captif lors d'une croisade avec Amaury V de Montfort en 1239. Libéré, Gui IV seconda Saint Louis à la bataille de Taillebourg en 1242 avant de mourir en 1263. Les enceintes du château subiront divers changements radicaux, composé au départ de terre plein , vers le XIIIe siècle les premières murailles sont construites. En 1263, Hervé de Chevreuse frère de Gui IV, seigneur de Maincourt hérita de la seigneurie. En 1272, quelques années après la mort de Saint Louis à Tunis, Anseau de Chevreuse sera nommé maréchal de Sicile et c'est probablement sous son règne que d'importantes modifications furent apportées au château, avec notamment la construction de mâchicoulis. Il se mit au service de Philippe le Bel et fut grand Queux de France et porta l'oriflamme avant de mourir en 1304, étouffé dans son armure au cours de la bataille de Mons en Puelle. La seigneurie passa ensuite par les femmes d'Amboise puis de Trie avant d'être vendu. En 1356, le château change de mains : Ingerger le Grand, seigneur de Chevreuse et d'Amboise, lors de la bataille de Poitiers, est fait prisonnier et envoyé en Angleterre. Il est contraint de vendre son domaine pour payer sa rançon. Le futur Pierre de Chevreuse le rachète en 1366. Les fortifications existantes sont grandement améliorées en 1370 sous les règnes de Charles V puis de Charles VI en 1384, qui financent les travaux grâce aux impôts royaux (100 francs or de l'époque). L’enceinte du château bénéficiera d’une extension importante, puisque tout le village sera entouré d’une fortification. Le château, celui que nous connaissons aujourd’hui, se renforcera avec la création de mâchicoulis sur arcs et d’une fortification totalement renouvelée pour faire face aux progrès constants des nouvelles machines de guerre. En 1417, la coalition dirigées par le duc de Bourgogne Jean sans Peur , les forces anglaises et bourguignonnes attaquent le château et s’en emparent et c’est seulement en 1438 que les forces royales françaises reprendront le château. En 1440, Nicolas baron de Chevreuse et arrière petit fils de Pierre, devient propriétaire du château. Les travaux de réparation et de renforcement sont achevés sous Louis XI (1461-1483). Tout comme le château, la ville est elle aussi fortifiée : on construit un nouveau rempart crénelé haut de 3,50 mètres et muni de tourelles. Les défenses sont complétées par un fossé 15 mètres.
A la renaissance en 1543, la baronnie de Chevreuse, érigée en duché par François Ier, est offerte par ce dernier à sa favorite Anne de Pisseleu. En 1551, Dampierre et le duché de Chevreuse sont achetés par Charles de Guise, cardinal de Lorraine et archevêque de Reims. Dampierre devient la résidence des ducs de Chevreuse. En 1589 Occupation du château par les troupes de la Ligue. Au XVIIe siècle, vers 1661, Jean Racine supervisa des modifications du donjon; le chemin qui va de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs jusqu'au centre-ville de Chevreuse en passant par le château de la Madeleine a été baptisé de son nom. En 1663 Le duc de Luynes se verra offrir le château par la duchesse. En 1692, Louis XIV, comme à son habitude, impose l’échange du château contre le comté de Montfort dans le but d'agrandir son parc de Versailles. Un an plus tard il cèdera ces terres aux Dames de Saint-Cyr, auxquelles ce domaine appartient jusqu'à la Révolution. En 1755, la chapelle de la madeleine sera détruite sur ordre de l’archevêque de Paris. La révolution bat son plein et en 1793, comme beaucoup d’autres biens, il sera confisqué comme bien national. En 1823 le château est transformé en ferme et en 1853 le duc de Luynes achète les ruines de la haute cour. Mr Goupil achète le château en 1978 et le revendra en 1981 au Conseil général des Yvelines.
Les armes de Chevreuse se blasonnent ainsi : D'argent, à la croix de sable chargée de cinq molettes d'éperon d'or, cantonnée de quatre lionceaux d'azur.
Notes sur les seigneurs de Chevreuse: Les sires de Chevreuse figurent souvent dans l'histoire comme guerriers et négociateurs, ils avaient le singulier privilège de porter sur leurs épaules l'évêque de Paris, le jour de son intronisation solennelle.
III Plan des lieux :
a) Vers 1120:
b) Vers 1450:
c) Entre 1700 et 1990:
IV Descriptif du site:
1.Le château fort de la Madeleine
1-1) Le site
L'abbaye Saint-Saturnin existe déjà en 975. Son histoire est tributaire de l'évolution du château féodal de la Madeleine et de ses propriétaires successifs, parmi lesquels la famille de Chevreuse, Charles de Lorraine ou le duc de Luynes. La construction de La Madeleine s'inscrit dans le cadre des luttes féodales, notamment pour résister à l'expansion des Capétiens à partir de Paris. Dès le milieu du XIIe siècle, les Chevreuse sont ralliés à la monarchie et accompagnent les rois lors des croisades. Les fouilles réalisées entre 1979 et 1994 par le Service archéologique départemental ont révélé les nombreuses étapes de construction de cet édifice. Le donjon était à l'origine plus long et plus haut. Un mur de pierre sèche, élevé sur un talus de terre, précédait l'enceinte en pierre. Au XIIe siècle, un grand bâtiment, aujourd'hui disparu, est construit à côté du donjon. Il s'agit probablement de l'aula, où le seigneur rendait la justice et accueillait ses hôtes. L'enceinte en pierre, construite à la fin de ce siècle, est remaniée à maintes reprises. Les travaux les plus importants sont effectués dans les années 1370 par Pierre de Chevreuse, qui fait notamment édifier, dans des blocs de meulière, le rempart nord et ses tours circulaires. Dans les années 1440-1450, Nicolas de Chevreuse relève le château des ruines de la guerre de Cent Ans. Il fait reconstruire le châtelet d'entrée à pont-levis et les tours carrées qui dominent la ville et ajouter des bâtiments d'habitation sur le front sud de l'enceinte. Le château doit son nom à sainte Marie Madeleine à laquelle étaient dédiées deux chapelles seigneuriales aujourd'hui disparues. Restauré en 1988 par le Conseil général, qui en est propriétaire, le château abrite la maison du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il est alors possible de visiter gratuitement (pour l'ensemble du château) quelques pièces et couloirs où une exposition retrace l'histoire du château.
Les vestiges intacts sont les suivants :
une enceinte basse avec porte, contreforts et reste de guérite;
une enceinte complète avec deux tours carrées à l'est, face au village ;
la porte principale du XVs, entourée de deux tours refaites dans leur partie haute. Le fronton en pierre s'est écroulé et a été remplacé par un linteau en bois ;
trois tours rondes dont l'une est semi-circulaire, une surmontée d'une tourelle de guet et une ouverte à la gorge;
un donjon dont il reste de petites fenêtres ou ouvertures du XIe siècle et sur l'autre façade des fenêtres du XIVe ou du XVe siècle, intérieur avec pilier central en cours de restauration;
un puits du XIVe siècle avec sa margelle gouttière;
des mâchicoulis sur arcs bandés du XIVs, au sommet des remparts;
les salles basses des logis XVIIs sur base plus ancienne, démolis lors de la création de la maison du parc régionnal;
Une poterne donnant vers la ville.
1-2) La basse cour
a) L'enceinte basse:
La basse cour du XIIs devenu trop juste fut aggrandie au XIVs
Les lices:
Le mur à contreforts "Les Braies":
La guérite:
b) La porte basse:
c) Les fossés:
- En eau et Sec
- Digues Nord et Ouest
d) Les communs: la grange du XIVs:
Seule la Grange à l'Est est d'époque, elle date de la fin du XIVs car le reste des bâtiments ont été refait en 1726 car ils menaçaient de tomber en ruines.
e) La chapelle Sainte Madeleine:
La chapelle Sainte Madeleine, dont l'entretien relevait du chapelain, étant presque en ruines en 1755, fut démolie sur ordre de l'archevêque de Paris.
1-3) La haute cour
a) Les fossés:
b) L'enceinte haute:
Enceinte en partie du XIIs, épaulé de tours semi circulaire, découvertent lors de fouille du château.
c) Le chatelet XIV-XVs:
La porte du XIVs était protégée par des douves où l'eau était retenue par une digue et servait sans doute aux usages domestiques. Un ponts-levis permettaient la circulation des véhicules et des piétons. En 1711, pour donner accès aux charettes du fermier, la double porte piétonne et cavalière du XVs, située entre les 2 tourelles Ouest, est abattue avec le mur qui la surplombe. Chaînages, jambages en grès, déblais sont jetés dans le fossé comblé à cette occasion, faisant disparaître le pont dormant. Le passage attenant à l'ancienne chapelle disparue est aussi élargi pour faciliter l'accès depuis l'ancienne basse cour aux chariots du fermier. La porte est en partie refaite après 1988 (voûte).
d) Les machicoulis du XIIIs:
e) La tour des gardes ou de Bretagne:
Cette tour "donjon du XIVs", a 4 étages couverts de voûtes d'ogives à pîles centrale, elle est habitable en autonomie, grâce à sa tourelle d'escalier en vis et ses latrines hors d'oeuvre. Cette tour possède des caves du XIIIs.
- L'intérieur:
f) La tour Du Gesclin:
Cette petite tour du XIVs ouverte à la gorge, n'a peut être été fermée sur cour qu'au XVs.
g) La tour Charles V:
Cette tour du XIVs, non voûtée, était pourvue d'un escalier en vis, de cheminées, de latrines et d'un étage supérieur ceinturé par le couronnement à mâchicoulis.
h) La cour:
i) Le puit:
Ce puits du XIVs, profond de 85 mètres, équipé d'une margelle creusée en gouttière, était destiné à assurer l'approvisionnement en eau des habitants du château en cas de siège.
j) Le donjon barlongue XIs:
Cette tour barlongue à contreforts plats, qui constitue l'élément principal du système de défense du château, mesurait 27 mètres de long (3 travées) sur 12m de large (2 travées) au XIe siècle. Les 4 contreforts sur la longueur et les 3 sur la largeur ont une taille moyenne de 1m de large pour 0,50m de profondeur.
Un contrefort est construit au XIVe siècle, après la destruction de la partie méridionale, le donjon est raccourci de 10m en longueur et le mur de refend devient mur de façade Sud. L'accès à la grande salle du premier étage se faisait au moyen d'une échelle, le rez-de-chaussée obscur servait de cellier. Le second étage servait de salle et de chambre (présence d'une cheminée) pour les dames, le troisième était occupé par les soldats. Des aménagements intérieurs d'origine, on reconnaît une pîle carrée délestant le plancher de l'étage, les pîles octogonales qui la surmontent aux étages supérieurs semblent plus tardives. La porte s'ouvrait au premier étage à l'Est, une vis dans le mur Ouest reliait la salle basse à l'étage, un escalier droit à l'Est reliait le premier niveau au second. On voit des baies cintrées, des latrines débouchant à l'Ouest (dans les fossés du XIIs).
L'intérieur a été redivisé au XVs et ses étages ne correspondent pas à ceux beaucoup plus haut sous plafond du XIs, de nouvelles fenêtres furent perçées (à meneaux) suite à la transformation du donjon défensif en lieu résidenciel. En 1717, le conseil des dames de Saint Cyr pense qu'il conviendrait de démolir le donjon tout à fait inutile, decision qui n'est pas appliqué. Un toit en batière a été construit en 1732 en remplacement du toit à 4 pentes pour sa transformation en silo à grains, reduisant ainsi le donjon d'un niveau. En 1733, son mur côté ville s'effondre entièrement et sera reconstruit moins épais avec un contrefort extérieur et un pilier butant à l'intérieur. Il semblerait que le donjon a été partiellement restauré au XIXe siècle. Les dernières modifications datent du XXe siècle. Des pièces de monnaies datées de 1030, découvertes en cours de fouille daterait le donjon de cette époque.
- L'intérieur du donjon:
k) Le logis et ses salles basses:
Les logis du XVIIs sur base plus ancienne, ont été démolis en 1988 lors de la reconversion du château en maison du parc. On voit de nos les restes en sous sol de 2 salles basses avec leurs couloirs d'accès du XVs.
- Salles basses:
l) La Poterne du XIVs:
m) L'Aula du XIIs:
L'aula, grande salle accueillant les manifestations de la puissance seigneuriale, est construite par Milon III au XIIs et démolie au XVs. Aujourd'hui, ne subsiste à l'Est de la haute cour qu'un mur percé de 2 fenêtres séparant la haute cour de la basse cour.
n) Les machicoulis sur arcs bandés du XIVs:
o) La Tour de Seigneur début XVs:
p) La Tour de la Châtelaine début XVs:
q) La tour contrefort:
r) La tour du batailleur:
2.L'enceinte urbaine XII-XVIs
2-1) Le site
2-2) Le Mur d'enceinte
Enceinte des XV-XVIs visible dans un champ, en contrebas du château, prés d'une tour circulaire. Amorce du mur d'enceinte du XIVs entre le château et la ville et XIIs autour du prieuré.
a) L'enceinte du XIIs et sa porte fortifiée "Enclos du Prieuré":
b) L'enceinte du XIV "Raccordement au Château":
c) L'enceinte des XV- XVIs et ses tours à canonnières "Jardin des potagers":
2-3) Les portes
Reste visible de l'enceinte urbaine du XIIs et des vestiges d'une porte prés du Prieuré Saint Sauveur.
2-4) Les tours
Deux enceintes successives, raccordées au rempart du château, clôturent la ville ancienne. La première, construite entre 1380 et 1420, et la seconde, élevée entre 1562 et 1598, englobent la rivière Yvette et les jardins potagers au sud. Les sept portes ont disparu. Seuls subsistent des pans de murs et des vestiges de tour, parmi lesquels cette tour ronde située à proximité de l'ancienne Porte de Paris.
3.Le Prieuré Saint Saturnin
3-1) Le site
Le prieuré du XIs, subit de graves dommages lors de la guerre de Cent Ans. Plus tard, il est partiellement démoli à cause du percement d'une ruelle rejoignant l'église. Après la Révolution, il est utilisé comme chai puis comme école communale. Il a été récemment restauré. La structure intérieure initiale, avec ses voûtes d'ogives, ses colonnes octogonales et ses chapiteaux, demeure intacte.
L'église du XIIIs attenante au prieuré, pourrait dépendre de celui-ci. L'édifice primitif a été remanié à plusieurs reprises au cours des siècles. Le clocher date du XIIIe siècle, la nef gothique est flanquée de collatéraux repris, ainsi que le choeur, au XVIe et au début du XVIIe siècles. La flèche est ajoutée à la fin du XIXe siècle. Après l'affaissement de plusieurs piliers, en 1949, la population s'est mobilisée pour empêcher la démolition préconisée et assurer la sauvegarde de l'ensemble.
a) La chapelle du XIIs:
b) Les bâtiments conventuels des XII-XVIs:
c) L'enceinte et la porterie:
4.Le maison du Prévost ou "des Bannières"
4-1) Le site
En 1188, le bourg de Chevreuse obtient le droit d'élire un prévôt et des échevins (conseiller municipal). Dans cette maison du XIVs, le prévôt de Chevreuse percevait les droits de banalités, ou droits baniers, dus pour l'utilisation du moulin, du pressoir ou du four du seigneur. L'escalier est logé dans une tour polygonale hors oeuvre, selon un dispositif rarement employé dans le département. Cette maison est percée de larges fenêtres à meneaux et pommelle octogonale. Les caves profondes de cette maison communiquent dit on avec le château.
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Maurepas et la Villedieu, donjon circulaire du XII, Tome IV
MAUREPAS
La merveille des merveilles
Et la commanderie Templière de VILLEDIEU
Les Donjons circulaires du XIIs, Tome IV
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La commune est située à 20 km environ au nord de Rambouillet, en bordure de la route nationale 10. La commune est assez boisée : une forêt domaniale, une forêt privée (le Bois-Prudhomme) et un petit bois transformé en square urbain (le Bois de Nogent).
Le nom de la commune vient du latin Mala Repasta, devenu Malrepast au début du Moyen Âge, puis finalement Maurepas à la Renaissance. Certaines sources traduisent Mala Repasta par mauvais passage, d’autres par mauvaise pâture ou encore mauvais repaire, un endroi ou on est mal reçu (type Malmaison) comme une mauvaise auberge. Endroit peu hospitalier ou l'on fait maigre chair; ce lieu viendrait de ce que les voyageurs qui passaient par là, en raison de la pénurie du lieu, trouvaient en cette châtelellenie, un pauvre logis et une pauvre table, d'ou Mal-Repast, Maurepas, Malmaison ou Malataverne. La tradition locale privilégie la dernière traduction, arguant du fait que le château a été effectivement un mauvais repaire car occupé par des brigands au XVe siècle. Cette explication repose cependant sur un anachronisme, car le nom est attesté dès le VIIIe siècle (donation de Pépin le Bref). L’hypothèse mauvais passage renvoie à d’autres toponymes lié aux voies gallo-romaines : le nom Maurepas (ou encore Le Maupas) correspond souvent à la traversée d’une zone de marécages ou à un franchissement à gué difficile (cf. le quartier de Maurepas à Rennes), ce qui est cohérent avec la géographie locale. Cette châtellenie était peu distante de celle de Chevreuse, de Neauphle le Château et aux terres du comté de Montfort.
Après le départ des romains, les périodes d’invasion se succèdent, dont celles des normands. Pour se défendre, les paysans se regroupent sur de la butte qui domine la vallée. Les terres appartiennent alors au roi de France. Pépin le Bref les donne à l’abbaye de Saint-Denis en 768. Les terres de Malrepast appartiennent alors à l'abbaye de Saint Denis. Face au danger Normand, l'abbé décide de céder la châtellenie à une famille du terroir, capable de la défendre efficacement. Cette famille prend alors le nom de la terre (Malrepast), tandis que les paysans se regroupent autour de la demeure des Malrepast et qui devient le vassal du seigneur de Chevreuse. Progressivement, l´ancienne demeure de bois est remplacée par un château de pierre, plus à même de résister aux invasions, aux pillages ou aux incendies. Vers 1060, sous le règne de Philippe 1er, le seigneur de Malrepast est le vassal du seigneur de Chevreuse, dont le suzerain est le seigneur de Choisel. Il doit donc aider le seigneur de Chevreuse à rendre justice, à faire la guerre et partir en croisade à ses côtés. Il doit participer au financement du mariage de la fille de son suzerain, à la dotation du fils qui entre en chevalerie, de la rançon en cas d’emprisonnement. En 1122, Milon de Mal-Repast est seigneur du lieu, son fils Simon est tué en 1176 par Simon de Neauphle. En 1205, Guillaume seigneur du lieu et sa femme Marie font des donnations. En 1212, le seigneur Richet de Mal-Repast et sa femme Aveline font des donnations aux templiers. En 1227, Nicolas de Manon est seigneur de Maurepas et avec sa femme Alix, ils font également des donnations aux templiers, dont "la moitié de la forêt de Maurepas".
Seigneurs connus de Maurepas: 1237, Milon II de Mal-Repast - 1254, Guyard de Montjoie - 1255, Aimotès de Maurepas - 1272, Amaury de Maurepas - 1275, Jean de Maurepas.
En 1276-1282 , changement de hiérarchie : Monsieur de Choisel fait hommage à l’évêque de Paris, et deux ans plus tard lui vend ses droits sur la châtellenie de Malrepast. Un cartulaire de l'église de Paris en fait plusieurs fois mention de ce lieu et l'appelle "château et châtelellenie de Maurepas, fief mouvant de l'évêque de Paris situé dans le Doyenné de Montfort". Ce fonctionnement de rendre hommage pendant le règne des Capétiens, puis des Valois perdure malgré une suite de famines cycliques, notamment celle déclenchée par la guerre de cent ans, où les soldats du roi Philippe VI pillent, tuent. La famille de Malrepast s’appauvrit tant qu’elle doit vendre ses terres et finit par s’enfuir. A cette époque, le Dauphin Charles cède par le décret de Calais, un tiers de la France aux anglais. En 1350, le riche Ingerger se prétend sire d’Amboise, de Chevreuse et de Malrepast est obtient 2 « arrière fiefs », Moulineuf et Villeneuve. Avec la guerre de Cent Ans, le château est abandonné et en1364 le château devient le repaire d’une troupe de brigands commandé par le seigneur brigand, Haymond de Massy, les villageois s'enfuis, les brigands rançonnent les voyageurs, terrorisent, assassinent. Cela dure de1364 à 1432 malgré la cession de la châtellenie à Pierre de Chevreuse (en 1367). C’est le Comte d’Arundel, seigneur de Maltravers qui met fin à cette situation en 1432. Il est lieutenant Angleterre et du Régent, avec une armée de 1200 archers et 400 lanciers, il est chargé de reprendre toutes les forteresses de la région de Montfort. Le 11 septembre 1432, ils prennent la Malrepast. Il semblerait que la tour aurait été coupée dans le sens de la hauteur afin qu’elle ne puisse être reconstruite, à moins que ce ne soient les paysans de retour à Malrepast qui aient eu besoin pour la reconstruction de leur propre maison. De même, aurait disparue la forteresse située au milieu des douves toujours existantes, faisant aujourd’hui parti de la ferme Belledent. Ce bastion, relié par souterrain, aurait en effet permit d’observer l’arrivée d’ennemis non visibles de la seigneurie. Mais le roi Louis XI ne peut maintenir l’ordre, la famine règne et les impôts sont très lourds.
La châtellenie de Maurepas change trois fois de propriétaires en cinquante ans : Maison de Chevreuse, duc d’Etampes, et Cardinal de Lorraine en 1577, pour un siècle, sans toutefois s’intéresser de cette terre. La baronnie de Maurepas appartient encore à la maison de Chevreuse qui la vend en 1543 au duc d’Étampes dont la femme Anne de Pisseleu est la maîtresse de François Ier. Avec la disgrâce de la duchesse, Maurepas est revendue dès 1551 au cardinal de Lorraine. Le cardinal désigne Jean du Fay, duc de Chevreuse, comme intendant. C’est lui et ses héritiers qui gèreront effectivement Maurepas pendant un peu plus d'un siècle. La misère paysanne reprend pendant la guerre de trente ans (1618 – 1648), des hommes sont enlevés, vêtus aux frais des villageois et enrôlés, les vivres sont volés, les impôts relevés. Les intempéries, déluge en 1651, sècheresses de 1662 et 1693 détruisent les récoltes amenant disette et épidémies de peste. L’église Saint-Sauveur reçoit 1659 deux cloches offertes par ses descendants Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, et Charles d’Albert, duc de Luynes, le favori de Louis XIII. L’une des cloches sera fondue à la Révolution. En 1621, le cardinal de Richelieu impose la destruction totale de la forteresse de la plaine, et il ne reste que les angles de l’église paroissiale, la porte ogivale, la ferme et ce que nous voyons encore aujourd’hui du donjon, réduit en hauteur, et tronqué de sa moitié. En 1691, le village est érigé en comté, et donné au Comte de Pontchartrain, Louis Phélypeaux, d’une famille blésoise anoblie au XVs. Intendant des finances, puis secrétaire d’Etat en 1690, sa carrière est couronnée par les postes de Chancelier et de Garde des Sceaux en 1691, et par le don du Comté de Maurepas. Lors de la construction du château de Versailles, un vaste chantier est lancé pour collecter toutes les eaux de la région afin d’alimenter les bassins et les fontaines. Deux rigoles sont creusées sur le plateau de Maurepas à partir de 1684 ; elles se rejoignent dans un bassin sec (l’étang des Bessières) puis un aqueduc enterré conduit l’eau vers l’étang des Noés (il passe encore sous le centre-ville actuel). Ce drainage permet d’assécher les marécages et l’agriculture peut se développer sur le plateau, le village est érigé en comté et octroyé à Louis Phélypeaux, chancelier et Garde des Sceaux de Louis XIV en 1691. Le petit fils de Phélypeaux, comte de Maurepas, sera ensuite ministre de Louis XV et de Louis XVI. Tombé en disgrâce aux yeux de Louis XV, il connaîtra un exil de 25 années, qu'il consacrera à la gestion de ses terres. Jean-Frédéric Phélypeaux devient alors Monsieur de Maurepas. Rappelé par Louis XVI, son exil prend fin et il devient président du conseil d'État. Il servira le Roi jusqu'à sa mort, en 1781.
En 1780, le Comte de Maurepas, Jean Frédéric Phélypeaux fait aménager Saint Sauveur. À la veille de la Révolution, Phélypeaux étant mort sans descendance, c´est le duc de Cossé-Brissac qui devient le nouveau seigneur de Maurepas.
Les armes de Maurepas se blasonnent ainsi : D'azur semé de quartefeuille d'or au franc-quartier d'hermine.
Aparté sur les devoirs du seigneur envers le peuple:
Le seigneur de Malrepast a aussi des devoirs envers les vilains du lieu : il doit les protéger en temps de guerre, leur fournir du travail, et rendre justice.
Ces devoirs lui donnent des droits qui, habilement renforcés, sont une lourde charge pour le peuple. En effet, le seigneur possède les serfs corps et âmes : ils doivent verser humblement un impôt (chevage) « en guise de reconnaissance », payer le droit de se marier avec une fille étrangère au village (formariage), payer un lourd tribu pour être affranchi, l’héritage du serf mort sans descendance revient au seigneur. Le statut du serf est quasi le même que celui de l’esclave dans l’antiquité.
- Les terres appartiennent toutes au seigneur.
Autour de la demeure du Seigneur s’étend le mansus indominicatus, c’est-à-dire sa réserve personnelle contenant jardins, pièce d’eau, réserve de chasse, et les champs cultivés par les serfs et vilains. Au-delà, la terre est morcelée en manses, exploitations cultivées par les vilains (paysans) Malrepastiens qui versent une redevance au Seigneur, les censives.
- Le seigneur possède aussi des heures de travail des vilains malrepastiens.
Trois jours par semaine servent à la construction du château et de la chapelle, à l’entretien des bâtiments, des chemins, à la culture de la réserve seigneuriale. Les habitants paient donc un bon prix la protection contre un éventuel envahisseur.
III Plan des lieux :
IV Descriptif du site:
1.Le château fort
1-1) Le site
Au IX ème siècle, la famille de Malrepast fait jucher sa demeure sur une motte artificielle édifiée pour accroître le champ visuel en cas d’attaque ennemie. Il s’agit d’un édifice en bois de trois étages, le sous-sol étant creusé dans la motte. Au XI ème, elle est reconstruite en pierres, plus solide en cas d’attaque ou d’incendie, au même emplacement. Les vilains charrient des tonnes de meulières des carrières environnantes, et les maçons entreprennent la construction qui durera 3 ans ! Des souterrains sont creusés pour rejoindre la maison comtale de Montfort et le château du seigneur de Neauphle distantes d’une dizaine de kilomètres. Il s’agit d’un édifice rectangulaire, inscrit dans une cercle de cent pas de diamètre, découpé de crénelages protégeant le chemin de ronde, le tout entouré d’un large fossé. Il reste aujourd’hui l’ouverture ogivale d’arcade en tiers point, pratiquée au nord de l’enceinte. Le seigneur de Malrepast a commandé un lourd pont-levis pour franchir le fossé.
Une chapelle était nécessaire à la vie de la communauté. Elle a été construite en meulières, accolée à la seconde porte intérieure de la forteresse, dans la « baille » (la basse-cour) pour le Seigneur et les villageois. Dès le XI ème siècle, elle comportait deux travées pour le chœur et trois pour la nef. Elle était décorée par des motifs géométriques peint sur l’enduit (il reste quelques traces), une colonne massive surmontée d’un chapiteau orné de motifs végétaux et de clés en tête à tête révèle l’existence d’un petit collatéral à deux travées , la voûte était en bois. La maison du chapelain est accolée à la chapelle.
Les communs qui regroupent les divers artisans (forgeron, charron et tailleur) se serrent au nord ouest, entre le puits et la mare, et le four et le pressoir, séparés de la demeure seigneuriale par un mur crénelé.
Au-delà, le donjon, masse de 20 mètres de haut et 17 de diamètre, domine les écuries seigneuriales. Il était surmonté de 4 échauguettes sur les contreforts destinée au guetteur.
L’ensemble de ce bâti assure la protection de la population de Malrepast. Construction et entretien sont donc assurés par les paysans (jours de Corvée). De plus ils doivent régler un certains nombre de redevances comme les banalités : paiement par une part des récoltes pour l’usage du pressoir et du four.
1-2) L'enceinte basse
Une enceinte basse est visible dans le parcelaire dont on voit une amorce le long de la porte basse.
1-3) La porte basse
Porte en arc brisé attenant à l'église est datable du XIIIs.
1-4) La Chapelle castrale Saint Sauveur XI-XVIs
Origine de l’église de Maurepas-village : une modeste chapelle seigneuriale. En 768 Pépin le Bref fait la donation des terres de « Malrepast » à l’Abbaye d’Argenteuil. Au Vlll ème siècle, le seigneur de Malrepas (Maurepas) s’installe sur une « motte féodale » (élévation de terre artificielle servant d’assise au premier château fort en bois). Sur cette butte se met en place le système féodal, un château et une chapelle qui sont construits conjointement certainement en boispuis construite en meulières en même temps que le Donjon . Cette construction fut édifiée dans la « baille » ou basse-cour ;Eglise au châtelain et à la communauté villageoise.
Au XI ème siècle , le château de bois est remplacé par une construction de pierre : une tour de 20 m de hauteur. Autour d’elle, en contrebas, un ensemble de petits bâtiments dont la chapelle, indépendante des autres constructions. Cette chapelle constitue le chœur roman de l’église actuelle où se trouve l’autel.
A cette époque existe le pilier dit « carolingien » orné de motifs végétaux.
A l’origine, ses murs sont couverts d’enduit peint de figures géométriques. l’ entrée est à l’emplacement de l’actuel vitrail de l’Annonciation. Pendant la guerre de cent ans, l’église subit de multiples abus (pillage ; incendie….) Les villageois souffrent et meurent de faim. En 1432 ; les Anglais prennent la maison forte. Le château est démantelé, l église reste ouverte à tous les vents. Alors, les paysans se servent des pierres de la forteresse pour construire leurs masures. la voûte qui avait brulé sera recontruite. Le porche couvert est appelé « caquetoire ». Elle est construite en pierres calcaires meulières jointoyées à chaux et à sablemarque sans doute la sortie principale de la , à l’identique du donjon cylindrique. Le tout était alors entouré d’une palissade et d’un pont-levis. L’arc devant l’église actuelle palissade et l’emplacement du pontultérieurement par une nef de trois travées. -levis. Au 16ème siècle,on a de nombreux fidèles, d’un coté les femmes et de l’autre, les hommes. Elle sera complétée Celledéplacée vers le côté, protégée par un porche, lieu -ci, effondrée, est refaite au début du XVIème, plus cintrée et surbaissée. Le sol est garni de carreaux de terre cuite. La sortie du fond de l’église est de réunion de la communauté villageoise sous la protection de « Nostre-Dame » et « Saint-Sauveur ».
1-5) La motte castrale
A l'angle méridionnal de ce château, une motte de plan circulaire de 30m de diamètre et haute d'environ 2m porte les restes du donjon circulaire.
1-6) L'enceinte haute
Il reste essentiellement des murs épais de 1,20m à 1,80m suivant l'orientation, épaulés de contreforts carrés rehausés d'échaugettes.
- Echauguettes:
- Contreforts:
- Poterne:
1-7) Les logis XV-XVIs
Ancien logis seigneuriale de 35m de long sur 20m de large, converti maintenant en ferme et entouré de divers bâtiments de ferme. A ces angles et sur les côtes, de massifs contreforts quadrangulaires portaient autrefois des échauguettes (dont une est conservée); c'étaient des guérites placées sur un point élevé, ou l'on pouvait surveiller les environs. La tour carrée dans laquelle s'ouvre la porte d'entrée date de la fin du XVIs.
1-8) Le donjon circulaire
La moitié d'un donjon circulaire (du dernier quart du XIs ou premier quart du XIIs) sur toute hauteur, qui faisait 17 mètres de diamètre à la base (en prenant les contreforts plats) et s'éleve à une hauteur d'environ 20 mètres. Ses murs sont épais de 2m, au centre s'élève un pilier rond (restes) de 3m de largeur sur 5m de haut qui supportait les planchers des 2 étages supérieurs. La salle du RdC est éclairée par 2 longues et étroites meurtrières à double ébrasement (intérieur et extérieur) caractéristique du XIs. Au premier niveau, sous une arcade plein cintre, s'ouvre une baie carrée (et l'amorce d'une seconde à l'ouest), deux portes étroites donnent accès à un double cabinet de latrines, éclairé par de petites meurtrières et un conduit d'une cheminée à l'Est implanté dans un contrefort. Au deuxième niveau, aucune ouverture de visible, juste le couronnement, des traces d'échauguettes sur les contreforts et des trous de boulin pour des hourds en bois.
- Cheminée:
- fenêtres:
- Archères:
- Latrines:
- Pilier Plancher:
- Chemin de ronde:
- Echauguettes:
1-9) Les fossés
Trace de fossés visiblent autour de la motte. De même autour de la haute cour on discerne des talus avec fossés correspondant à une defense avancée.
1-10) Les communs
Ils datent pour la plus des XVIs et XVIIs sur base plus ancienne, époque de la reconversion du château en ferme.
2.Elancourt, la commanderie Templière de Villedieu
2-1) Le site
Dans le "Polyptichus" d'Irminon, abbé qui établit un registre des biens de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés au IXe siècle , nous rencontrons la première mention du nom de la commune sous la forme latino-germanique d' « Aglini Curtis » , signifiant la ferme enclose ou l'exploitation d'Aglin ou d'Agil (antrhroponyme). Le nom évoluera ensuite en Herencurtem (1144), Elencuria (1250), Ellencourt (1472), jusque la forme actuelle Élancourt en 1757.
Le village de la Villedieu Lez Maurepas est une commanderie de l'ordre du Temple, paroisse d'Elancourt, archidiaconé du pincerais, doyenné de Poissy. La Commanderie a été fondée vers 1180 par les moines-soldats de l’Ordre du Temple. Parmi d'autres dons, la commanderie reçu de Gui II, seigneur de Chevreuse, à sa mort en 1182, les droits sur la terre de La Brosse (près de Lévis-Saint-Nom), donation qui fut confirmée par Simon de Chevreuse, fils du précédent et frère de Milon IV, son ainé, qui ne régna que de 1182 à 1190. De plus, celui-ci leur laissa, en toute propriété, avant son départ pour la troisième croisade, le village de Boullay-les-Troux, le bois des Layes à Auffargis et le haras installé sur le domaine. Lors de la dissolution de l'Ordre en 1312, tous les biens de la Villedieu-Maurepas furent placées sous l'obédience de la commanderie hospitalière de Louviers-Vaumion. Les terres, la chapelle Saint-Thomas et le grand vivier qui constituait la commanderie avaient été données en 1181 par Godefroy d'Ambleville aux frères de Jérusalem. L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem deviendra l’Ordre de Malte.
La coutume en vigueur sur le territoire de la commanderie était celle de Trappes, antérieure à l'an mille, qui fut règlementée en aout 1226 par Pierre d'Auteuil, abbé de Saint-Denis. Il n'est pas douteux que certains articles de ce remaniement soient en rapport avec des démêlés entre l'Abbaye et les Templiers, dont les possessions se trouvaient enclavées dans les terres Saint-Dionisiennes. Par la bulle Omne datum optimum que Saint Bernard leur avait fait accorder, les Templiers jouissaient de privilèges en rapport avec les services qu'ils rendaient ou avaient rendus en Orient. Exemptés d'impôts, de dimes, dépendants uniquement du Pape, exerçants leur propre justice, ils constituaient une entité qui était loin de plaire aux religieux de Saint-Denis et à beaucoup d'autres. La commanderie, sinon la chapelle, eut beaucoup à souffrir comme tous les environs des bandes de pillards, routiers et écorcheurs, ainsi que de l'occupation anglaise durant la Guerre de Cent ans. le domaine se trouvait dans un tel état de pauvreté à la fin des hostilités que, ne pouvant plus subvenir à ses propres besoins, il fut directement rattaché à l'hôpital Saint-Jean de Latran de Paris, dépendant du Grand Prieuré de France, en 1474. Durant les guerres de religion, le domaine fut rançonné par les troupes huguenottes en 1567 et 1568.
Nom des commandeurs connus de 1469 à 1789 |
Dates |
Guillaume Lesbahy |
1469-1506 |
Charles des ursins |
1506-1522 |
Guillaume Quignon |
1522-1549 |
François de Lorraine |
1549-1550 |
Pierre de la Fontaine |
1550-1567 |
Guillaume de la Fontaine d'Ognon |
1567-1569 |
Henri d'Angoulême |
1569-1577 |
Philibert l'Huillier |
1577-1597 |
Bertrand Pelloquin |
1597-1603 |
Georges de Regnier |
1603-1620 |
Alexandre de Bourbon |
1620-1630 |
Guillaume de Meaux |
1630-1639 |
Amador de la Porte |
1639-1645 |
Hugues Rabutin de Bussy............................. ... ...... |
|
Jacques de Souvray ou de Souvre |
|
Henry de la Salle |
|
Pierre de Culant, seigneur de la La Brosse |
|
François Noué de Villiers |
|
Jacques de Noailles |
|
Alexandre César d'O |
|
Francois le Maire de Parisis Fontaine |
|
Adrien Claude Le Tellier |
|
Joseph de Laval Montmorency de Montigny |
|
Alexandre Thomas du Bois Givry |
|
Joseph de Lancry Pronleroy |
|
Jean Bois Roger de Rupierre |
|
Louis François de Paule Le Febvre d'Ormesson |
|
Jacques de Rogres de Champigneulles |
C'est vraisemblablement vers cette époque qu'il n'y eut plus, et ce jusqu'à la Révolution française, qu'un receveur des terres (en quelque sorte un fermier) à sa tête et que la chapelle, si elle continuait d'être soigneusement entretenue, n'était plus desservie que de temps en temps par un moine de l'Ordre ou par le curé d'Élancourt, tous les jeudis, ainsi que l'atteste un acte de 1750. Il ne reste aujourd’hui des bâtiments originaux que la chapelle en pierre de meulière qui a été inscrite en 1926 à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Les autres bâtiments ont été construits ultérieurement, au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. En 1792, la Révolution française confisque les biens français de l'Ordre de Malte et vend l'ensemble, en tant que bien national. La commanderie devient une ferme et, en 1900, sera une des plus importantes de la région avec une douzaine d'ouvriers agricoles à demeure. À partir de la fin des années 1930, à la suite d'une expropriation, le site va rester à l'abandon jusqu'en 1970, date de la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'établissement public d’aménagement (EPA) en devient propriétaire. D'importants travaux de restauration sont alors effectués de 1971 à 1978. Après avoir abrité un office d’information de l’EPA et un centre culturel à vocation polyvalente, à savoir des expositions, des séminaires, des ateliers et des logements d’artistes ainsi qu'un restaurant. Les locaux sont aujourd'hui en cours de réaménagement. Les lieux sont aujourd'hui la propriété de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La Villedieu était une commanderie rectangulaire, telle qu'elle subsiste, malheureusement amputée d'un de ses cotés. Entourée de murs, elle était défendue par un ru. Ce fossé et les pièces d'eau qui existent encore, en partie du moins, avaient une surface de 4 hectares et demi. Ils constituaient non seulement des éléments de protection mais contribuaient largement à l'alimentation de la communauté dont la règle recommandait une faible consommation de viande.
2-2) La Chapelle
La chapelle de la Villedieu, qui est le dernier témoin médiéval de la région, est un gracieux édifice aux proportions élégantes de 28 mètres sur 8. Sa hauteur intérieure primitive était de 11,80 mètres à la croisée des ogives. les façades sont percées de 14 fenêtres ogivales de 6 mètres sur 1,40 mètre, séparées par des contreforts montant jusqu'au toit d'ardoise. il est rare qu'une chapelle templière soit éclairée avec une telle profusion. Ces fenêtres furent bouchées par les fermiers qui ouvrirent, selon leur fantaisie, des portes et bâtirent des appentis un peu partout.Sous l'unique ouverture de la façade, on trouve un porche surmonté d'une archivolte sculptée en pointe de diamant, signature indubitable du XIIe siècle, cette arcade repose sur deux consoles peu saillantes.
À sa droite et au pignon, une tourelle octogonale, dont l'accès se retrouve à l'intérieur de la chapelle, est coiffée d'un toit conique. Son escalier à vis, éclairé par des meurtrières, conduit au sommet se terminant en lanterneau. On rencontre rarement ce genre de tourelle dans les commanderies; elles sont généralement de surface circulaire. Signalons que la construction octogonale est considérée chez les templiers comme une architecture marquant un endroit initiatique privilégié. De fait, cette tourelle étant d'un diamètre plutôt réduit, on comprend mal pourquoi son concepteur a pris la peine de lui donner cette apparence; dans nombre de chapelle comportant une telle tourelle, cette dernière est incorporée à "l'intérieur" et n'est visible qu'à partir du toit à la manière d'une cheminée. Nous savons que des frères du Temple avaient été intronisés à La Villedieu, cérémonie qui n'avait pas lieu dans toutes les commanderies, ceci expliquant peut-être cela.
Sur la façade sud de la travée la plus proche du chœur, s'ouvrait autrefois une porte secondaire qui, si l'on considère les plans habituels des commanderies, devait donner accès au logis du commandeur. À l'intérieur, l'abside est à cinq pans. Les six arcs de voute, soigneusement moulurées, reposent sur de graciles colonnettes dont les astragales supportent des chapiteaux ornés de feuilles ou de crochets. Vers la droite du chevet, sous une arcade ogivale, s'ouvre dans l'épaisseur du mur, une piscine d'église à deux cuvettes: ronde et carrée. Trois travées d'égales dimensions succèdent au chœur. Leurs arcs sont portées par des culs-de-lampe en encorbellement décorés de feuillages différents à chaque élément-feuilles d'eau, de chêne, de trèfle. Les clés de voute sont toutes sculptées et il semble qu'elles comportaient des motifs issants qui ont disparus.
Le sol a été plusieurs fois remanié; abaissé lorsque la chapelle fut transformée en grange, on y découvrit huit pierres tombales qui furent sans doute récupérées comme matériau de construction. Le sol fut relevé à son niveau initial lors de travaux de restauration; on y découvrit des fragments du dallage originel. Des restes de vitraux furent également découverts. D'une grande simplicité, ainsi qu'il convenait au cadre de la chapelle, des médaillons en provenance de Saint-Denis, ont été incorporées à l'ensemble du chœur.
Cette chapelle ne sera dédiée qu'à saint Jean-Baptiste qu'après son transfert aux hospitaliers.
2-3) La Croix Templière
Cette croix du XIIs, gravée sur ses deux faces d'une croix templière inscrite dans un cercle, est déterrée lors de la restauration du bâtiment. Il pourrait s'agir d'un vestige d'ornement, d'une pierre tombale ou d'une borne territoriale. La croix templière marque tout ce qui appartient au Temple : hommes, maisons, champs et bétails. Elle est le signe que ces propriétés sont libres d'impositions. Parmi les autres emblèmes cruciformes de l'ordre du Temple se trouvent la croix celtique et la croix de Saint-Georges.
Lors des travaux de restauration dans les années 70, une pierre gravée sur les deux faces d'une croix templière inscrite dans un cercle, a été retrouvée. Tout comme à Westerdale ou à Arveyres, ces croix servaient très certainement de bornes territoriales. On peut voir cette borne aujourd'hui qui a été insérée dans la façade d'un bâtiment face à la chapelle avec les deux faces visibles.
2-4) Les bâtiments conventuels
Protégé par le ru, les bâtiment conventuels faisait office de rempart contre l'extérieur. Ils datent du XVIIs sur base des XII-XIIIs.
2-5) L'enceinte et les fossés
3.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Châteaufort et les Montlhéry, donjon circulaire tome III
CHATEAUFORT
Le site aux 5 Seigneuries
Les Donjons circulaires du XIIs, Tome III
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
Châteaufort est une petite localité située en partie sur le plateau de Saclay et dans la vallée de Chevreuse, en limite de l'Essonne. Elle fait partie du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Elle est irriguée par la Mérantaise, petite rivière affluent de l'Yvette. Commune du parc régional naturel de la haute vallée de Chevreuse, le village se développe sur un promontoire dominant la vallée de la Mérantaise jusqu'au hameau de la Trinité.
Quel contraste entre l'actuel village et la place forte du XIe siècle, siége du principal doyenné de l'évêché de Paris, auquel 98 paroisses étaient rattachées. À l'époque mérovingienne, la colline s'ornait d'un oppidum, remplacé à partir de 1068 par une imposante forteresse à trois enceintes passant pour être inexpugnable, dont les vestiges actuels de Montlhéry donnent une bonne idée. La première ligne des remparts joignait trois imposantes tours cylindriques : le donjon (dont seule subsiste la base) de 36 mètres de haut et de 20 mètres de diamètre, les tours de la Motte et de Marly, qui ont conservé leurs fondations et leurs souterrains.
Notre forteresse fut bâtie sous le règne de Philippe Ier (1060-1108), dernier roi sans pouvoir. En 1068, Gui I de Montlhéry, puissant seigneur de Chevreuse et de Rochefort possède un château à Châteaufort. Nos trois seigneurs d'alors, Gui de Châteaufort, Hugues de Crécy et le Chevalier Amaury, possédaient outre celle de Châteaufort, de nombreuses autres forteresses en Île-de-France. Ces places fortes sont les verrous du domaine royal. Le fils de Philippe Ier, Louis VI le Gros, comprit que son autorité royale passait par la soumission de ces seigneurs alentours, mieux armés. C'est ce qui perdit notre forteresse en 1118 : le roi provoqua chez notre sanguinaire seigneur Gui le Rouge une jalousie qui le poussa à assassiner l'un des siens, effectivement son fils Hugues de Crécy assassine son cousin Milon II de Bray à qui il voulait usurper la possession de Montlhéry. Cette année-là, Châteaufort, Gometz et Montlhéry furent démantelés, et rattachés au domaine royal. La guerre de 100 ans (1333-1453) détruira Châteaufort au point que ses habitants, si appauvris, devront vendre les cloches de l'église Saintle -Christophe pour permettre à la dernière de sonner encore. Ce sont des ruines que Louis XI offre à son écuyer Charles de Buz en 1467, en nommant Capitaine de Châteaufort. En 1482, seules six maisons méritent encore cette appellation. Le château royal (la tour de Marly) est « tout en ruynes ». En cette fin du XVe siècle, des agglomérations autrefois prospères comme Châteaufort ont perdu tout éclat et ne se remettront jamais complètement de leur désolation. Chevreuse, nichée au fond de sa large vallée, deviendra de plus en plus prospère. Le XVe siècle révèle un magnifique épanouissement rural : Magny ne compte pas moins de 27 hameaux et, à Toussus, le Plessis est fort peuplé. Le personnage le plus rayonnant de l'époque est sans contestation Jean d'Escoubleau (1488-1572), dont la famille enrichira la vallée pendant plus d'un siècle. Au XVIIe, Châteaufort continue de servir de pion dans les échanges seigneuriaux. Ainsi en 1629, quand Louis XIII le cède au Duc de Lorraine ; ainsi le 8 mai 1646, quand ce dernier l'abandonne au marquis, prince, comte et seigneur d'une région impressionnante, Jean d'Escoubleau (homonyme de son illustre aïeulC'est ). Hélas ! son successeur n'est pas de la même trempe : en 1673, il est dépossédé de presque toutes ses terres, dont Châteaufort. le 12 juillet 1675 que le village perd son droit de rendre justice : celle-ci se transporte à Chevreuse et le Champ de Justice, désaffecté, sera revendiqué par les villageois au vu qu'ils en assuraient l'entretien de tous temps et qu'ils y faisaient paître leurs bêtes. Ils n'obtiendront pas cette dernière grâce. Le Prieuré, naguère le plus riche du diocèse de Paris, ne vaut guère mieux que le reste du village : ses revenus sont au plus bas et l'on doit étayer l'église, dont les voûtes menacent d'ensevelir les paroissiens. En 1679, le Chevalier d'Albert, frère du Duc de Chevreuse, devient Comte de Châteaufort. En 1691, le seigneur de Châteaufort est le Duc de Chevreuse. Né en 1646, il épouse en 1667 la fille aînée de Colbert, s'installe au château de Dampierre et l'embellit tel que de nos jours. Il rachète Châteaufort et Magny et devient ainsi propriétaire de la majeure part de la vallée de la Mérantaise1er . Hélas pour lui, éduqué auprès des Solitaires de Port-Royal, et donc janséniste, il subit la haine de Madame de Maintenon. Lorsque, le février 1692, Louis XIV rattache Châteaufort au domaine royal, cette grande Dame en exigera la jouissance des revenus jusqu'à son exil final au Couvent de Saint-Cyr. L'hiver terrible de 1708-1709 mérite le récit. Le gel persistant plus de 60 jours avait immédiatement rendu « les rivières solides jusqu'à leur embouchurela , et les bords de mer capables de supporter de lourds charrois ». Un dégel trompeur fut suivi d'un froid polaire meurtrier. À Châteaufort, famine fut totale. Du 5 janvier au 2 février, pas moins de 24 000 habitants périrent de froid dans la région. Les intendants royaux valorisèrent leurs réserves de grain conservées en province en en raréfiant la vente. En 1767, Louis XV voit s'achever sept ans de la ruineuse Guerre Coloniale. Mais le roi ne rêvait que d'agrandir son domaine de Versailles en pillant le trésor public. Il y enclavera les terres du Prieuré Saint-Christophe ainsi que celles du Fief de la Grange. Il meurt le 6 mai. En 1787, le nouveau Prieur, affligé de tant de ruines, entreprend de gros travaux pour l'église, lesquels ne permettront que de consolider pour un temps. Pendant ce temps, les gentilshommes du Comte d'Artois ont tant de goût pour Châteaufort qu'ils investissent les fiefs du Gavoy et de la Geneste, où ils bâtissent l'actuel castelet. Cette même année, notre Prieur fait restaurer « le manoir » par l'architecte royal Gondouain. Le chantier, réceptionné le 12 avril 1791, nous vaut l'actuel prieuré.
Les armes des Châteaufort se blasonnent ainsi : De gueules au château fort d'argent maçonné et ajouré de sable, ouvert du champ, mouvant de la pointe, donjonné et flanqué de quatre échauguettes, le donjon chargé d'un écusson d'azur fretté d'or.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.Le château de Gui de Châteaufort "Le Donjon"
1-1) Le site
La moitié du niveau inférieur du donjon circulaire, qui faisait 18,60 mètres de diamètre à la base et devait s'élever à une hauteur d'environ 36 mètres, constitue le seul vestige du château fort édifié au XIe siècle par l'un des trois seigneurs du fief. Ces murs ont une épaisseur de 3m et contreforté de 4 larges saillants quadrangulaires, ce donjon conservé que sur sa moitié du niveau inférieur correspondant à une salle basse, on remarque un corbeau de pierre orné d'une figure grimaçante, un couloir de latrine et les vestiges de 2 archères à double ébrasement comme à Maurepas. Dominant la vallée de la Mérantaise, trois châteaux à portée de flèche coexistaient sur le site de Châteaufort. Celui-ci est intégré au domaine royal en 1108. Louis XIV en fait l'acquisition auprès du duc de Chevreuse en 1692 puis en fait don aux Dames de Saint-Cyr. Bien national en 1789 puis propriété privée à partir de 1840, il est par la suite détruit en grande partie.
1-2) Intérieur du donjon
1-3) Extérieur du donjon
Couloir de latrines Console à tête grimaçante
1-4) La haute cour
2.Le château d'Hugues de Crécy "La Motte"
2-1) Le site
Le Château du Gavois, inspiré du XVIIe siècle, est construit sur l'emplacement du château de la "Motte" d'Hugues de Crécy (tour en bois sur motte castrale). Le site se trouve à proximité de celui qui compte au Moyen Âge l'un des trois châteaux de Châteaufort dont il reste une motte castrale. Paul Henri Nenot, l'architecte de la Sorbonne, réalise en 1910 la terrasse et le pavillon à l'est. Ce château en brique et pierre, constitué d'un corps central entre deux corps latéraux dont l'un est flanqué d'une tour, est précédé en façade d'un escalier avec perron. Couvert d'un toit d'ardoise, il s'élève sur deux étages percés de fenêtres, lucarnes et d'ouvertures en forme de meurtrière sur la façade arrière.
Blason de Crécy-la-Chapelle: d'azur, à trois croissants entrelacés d'argent.
- Aparté sur la famille de Crécy: C'est à partir des IXe et Xe siècles que fut édifiée la première forteresse à Crecy en Brie ou Crécy la Chapelle (aujourd'hui). Isabelle, comtesse de Crécy, apporta en dot à Gui I dit le Rouge (voir bio sur Rochefort en Yvelines), comte de Rochefort, la ville. Gui et son fils Hugues se joignant aux ennemis du roi Philippe Ier de France dotèrent Crécy d'une redoutable défense. Comme dans toutes villes fortifiées, il y avait un château, des remparts, des tours (dont certaines existent toujours), des portes, etc. Par le jeu des mariages, Crécy échut à Gaucher II de Chatillon, vassal des comtes de Champagne. C'est à lui que l'on attribue les renforcements des fortifications et le creusement du dernier brasset.
2-2) La motte castrale
2-3) Le château de Gavois
3.Le château d'Amaury de "Marly"
3-1) Le site
Bâtie sur le sommet de la motte de Marly ' site de l'ancien château fort de Marly ', cette maison bourgeoise à travées s'élève sur deux niveaux et un étage de comble. Au XIe siècle, ce site accueillait l'un des trois châteaux forts que comptait le village. Possession du chevalier Amaury, il est appelé plus tard château de Marly. Le donjon démantelé en 1614 sert à la reconstruction du château de la Geneste. Le château de Marly carré flanqué de quatre tours cylindriques est entièrement détruit au cours du XVIIIe siècle.
Les armes de Marly-le-Roi se blasonnent ainsi : écartelé, au premier et au quatrième d'azur au soleil d'or, au deuxième et au troisième d'or à la croix de gueules treillissée d'argent et cantonnée de quatre aiglettes d'azur.
- Aparté sur la famille de Marly: A l’époque de la féodalité, au Moyen-Age, une importante famille de seigneurs "villageois", celle des "chevaliers de Marly", règne sur la région allant de Chambourcy à Saint Germain en Laye, tandis que d’autres familles seigneuriales possèdent des terres à Marly, les "de Vuicherens", "de Messel" ou "de Bennewyl". La ville de Marly eut, un château féodal qu'occupèrent ses seigneurs au Moyen âge, les Thibaud, les Mathieu, les Bouchard de Marly ; puis, la famille de Lévis au XIVe et XVe siècles, et la seigneurie passe à divers autres personnages jusqu'en 1676, époque à laquelle Louis XIV en fit L'acquisition. Ce château, dont il ne reste plus aucun vestige, était situé dans le haut du bourg, tout proche de l'église Saint-Vigor.
3-2) La motte castrale
3-3) L'enceinte
3-4) La maison bourgeoise
3-5) Les souterrains
Le sous-sol de Châteaufort renferme un réseau de galeries souterraines (XIs) qui reliait le donjon, le château de Marly et l'église. Un autre souterrain qui pouvait être utilisé par des carrosses, reliant Versailles à Chevreuse, passait par Châteaufort. Le souterrain situé sous l'école, d'une longueur de 9 mètres, est l'un des mieux conservés.
4.Le domaine de la Geneste
4-1) Le site
Sur le fief mentionné en 1554 existaient un château, un moulin à eau et un colombier aujourd'hui détruits. L'ancien château est reconstruit en 1614 avec des remplois du donjon du château de Marly. Détruit à son tour, un nouveau château édifié par Eugène Petit le remplace en 1857. De style classique, il est bâti selon un plan symétrique et possède un sous-sol et deux étages. Le château est flanqué à l'arrière d'une échauguette à toit conique et d'une tour carrée coiffée d'un toit conique orné d'un clocheton. La façade avant du corps central est surmontée d'un toit percé de lucarnes rondes et rectangulaires. Une partie du domaine accueille aujourd'hui un terrain hippique. Une grande tour ronde couverte de lierre est érigée à l'entrée du domaine de la Geneste. Sûrement bâtie en même temps que le château, elle est recouverte d'un crépi imitant la pierre qui disparait sous la végétation. Elle possède trois étages, des fenêtres en ogives ou cintrées et un toit plat crénelé. Cette tour d'inspiration médiévale confère au lieu une ambiance romantique ; elle est attribuée à Eugène Petit.
5.Le domaine d'Ors
5-1) Le site
Ce fut le plus imposant fief de Châteaufort, construit autour d'un modeste sanctuaire perdu à flanc de coteau (devenu la crypte de la chapelle). Ses 850 hectares se composaient d'un parc botanique autour du château sans caractère mais richement orné et meublé, de vastes communs et écuries, de maisons de garde-chasse et des bâtiments du moulin, dont la roue termina sa ronde au milieu du siècle dernier. Construit au cours du XIVème siècle, le fief d'Orce ou Ors est attesté en 1354 et un château y est édifié par Jean de Luynes. Au cours des siècles suivants le domaine accueille une chapelle, un moulin, des communs ' écuries, grange, sellerie, logement ' une glacière et un pont galerie. Ce fief fut embelli au début du XIXème siècle par son propriétaire brésilien, notamment par les crépis grisés des façades et le portail de la chapelle sur le modèle du château de Versailles. Jusqu'à la fin du siècle, Ors brilla d'un éclat remarquable. Occupé jusqu'en 1945 par l'état-major allemand, qui faisait réparer ses engins sous les bois du splendide parc, il fut rasé volontairement en 1951 et ses vestiges éparpillés dans toutes les vieilles demeures du village. Abandonné par son héritier en 1951, il sombra dans l'oubli jusqu'en 1984, date à laquelle furent créés les premiers spectacles historiques. Le domaine est alors racheté par la municipalité. On peut toujours admirer la chapelle, le moulin à eau récemment restauré par le Parc naturel régional, le bel ensemble des communs, le dôme abritant une rare glacière intacte, l'orangerie, les loges de gardes décorées de bas-reliefs de terre cuite (oeuvres d'Augustin Pajou, 1784), le pont-galerie, dont l'arche médiévale fut ornée d'arcades couvertes au début du XIXème siècle. L'emplacement du vaste château est aujourd'hui insoupçonnable. Il était avec le moulin la principale source d'emplois du village. La légende raconte qu'ainsi le dernier baron d'Ors voulut clore sa lignée en empêchant toute intrusion et qu'il put financer cette démolition en vendant l'une des deux boules de platine des paratonnerres. Il va sans dire que le sous-sol d'Ors est bien truffé de galeries, dont certaines sont bien conservées.La chapelle du domaine d’Ors, désaffectée, était l’ancien oratoire du château. Celle-ci a été rénové récemment par la commune, notamment son portique issu de l’Abbaye de Gif. Les constructions qui subsistent ' notamment les écuries ' sont mises en valeur par une association locale qui organise des sons et lumières sur ce site protégé. La petite chapelle du château d'Orce est élevée à l'entrée du domaine. Vers 1817, la façade de l'édifice reçoit un majestueux portail de la première moitié du XVIIe siècle, provenant de l'abbaye du Val de Gif-sur-Yvette. Flanquée de deux paires de colonnes ioniques, l'entrée de la chapelle est surmontée d'un large entablement coiffé d'un fronton à volutes, auquel est suspendue une guirlande feuillagée. Une statue de la Vierge sur un piédestal occupait autrefois le centre de cette élégante composition maniériste, qui était également encadrée de pots à feu. L'existence de ce moulin est attestée en 1694 avec celle du château d'Orce. Aujourd'hui propriété du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, il est en cours de réhabilitation. Un petit musée sur le thème de l'eau et des moulins y sera installé ainsi qu'un atelier de fabrication artisanale du papier.
6.Le Prieuré Saint Christophe
6-1) Le site
L’église Saint Christophe de Châteaufort date de 1848, style Napoléon III, autant dire sans style émotionnant. Elle fut reconstruite sur les ruines de l’ancienne église prieurale des bénédictins du XIIe siècle détruite à la révolution. On peut imaginer ce qu’elle devait être en contemplant la petite crypte du Prieuré contiguë, restaurée en 1982. L’église actuelle, joyeusement de blanc vêtue, a été décorée par les paroissiens et leur pasteur. On y remarque l’ancienne chaire provenant de Port Royal (1702) transformée en autel. La cloche et deux verrières datent de 1850. Sept vitraux sont de facture récente et le grand orgue a été installé en 1998. L'église du prieuré Saint-Christophe est élevée au XIe siècle, période où Châteaufort est un doyenné important du diocèse de Paris. L'église dépend à l'origine du prieuré bénédictin bâti au XIe siècle. Une chapelle est fondée en 1350 dans l'église. Celle-ci coexiste jusqu'à la Révolution avec l'église paroissiale de la Sainte-Trinité située sur le hameau éponyme et détruite en 1750. L'édifice actuel reconstruit comporte trois vaisseaux ainsi qu'une tour-clocher carrée surmontée d'une flèche polygonale qui s'élève contre le chevet plat. Installée en bordure de plateau, elle domine la vallée de la Mérantaise. Cette crypte, découverte au début des années 1980, est le dernier vestige du prieuré fondé au XIe siècle. Elle présente une remarquable voûte en ogives de la même époque et abrite l'entrée de l'un des nombreux souterrains qui sillonnent le sous-sol du village. Les chanoines de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre-de-Bourgueil construisent au XIe siècle un prieuré à l'emplacement de l'église actuelle. Au XVIIe siècle, il est l'objet d'une attaque des dragons du roi, provoquée par le soutien du curé de Châteaufort aux idées du jansénisme. Plusieurs propriétaires en font l'acquisition à partir de 1791. En 1868 il est donné aux s'urs par les Dames de Saint-Cyr, auxquelles Louis XIV cède la seigneurie de Châteaufort. Ce bâtiment s'élève sur deux étages avec un étage de comble couvert d'un toit d'ardoise percé de trois lucarnes. Celle du centre est placée dans une niche en meulière apparente, à pignon couvert.
a) L'église
La crypte romane XIIs
b) Les logis
c) Bâtiments conventuels
6-2) La Ferme de la Grange
Une ferme appelée la Grange aux Moines est mentionnée en 1500. Le corps de logis est bâti en 1877 et le dernier étage ajouté en 1909. Doté d'une élévation à travées, il est couvert d'un toit d'ardoise à pignon central. Les bâtiments sont aujourd'hui transformés en logements. Cette ferme possède encore un ancien travail à ferrer.
7.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Tremblay sur Mauldre & la Hunière
TREMBLAY sur MAULDRE "La HUNIERE"
GARANCIERES - GROSROUVRE- SAINT REMY L'HONORE
Les Donjons circulaires du XIIs, Tome II
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
Le territoire de la commune du Tremblay-sur-Mauldre, en pente vers le nord-est, s'étend sur le versant ouest de la vallée de la Mauldre au nord du massif forestier de Rambouillet, la rivière formant la limite est de la commune. L'habitat est groupé dans le bourg qui jouxte le château du Tremblay.
Le fief du Tremblay appartient dès le Haut Moyen Âge à la famille Mignon, dont le château s'élève au lieu-dit la Hunière, près de la chapelle Sainte-Geneviève. Le château fort de la Hunière (construit en 1118 par Simon de Gometz) date des XI et XIIs était dans le parc du château XVIs. Dès 1118 et 1142, il est question de ce château fort dont il reste encore des ruines. Il y avait autrefois aussi, au lieu dit la Hunière en latin Huaneria, une chapelle sous le vocable de Saint Geneviève, à la présentation des seigneurs du Tremblay. Anciennement Trembleium, Trembletanis, Trempleto, Trembletum et Trempletum, le Tremblay dépendait de la châtellenie de Maurepas, de l'archidiaconé du Pincerais et du diocèse de Chartres. Sité en 1228, le curé était Hugues. Les anciens seigneurs du Tremblay sont Geoffroy de Trempleto en 1162, puis Gautier et Evrard de Trembleio. Herbert donne un arpent de terre vers la grange d'Ayte avec le consentement de ses fils. En 1239, Amaury de la Hunière est en propriétaire. En février 1250, Geoffroy était seigneur de la Hunière, sa femme se nommait Philippa. En 1276, Joannes de Tremblaya devient exécuteur testamentaire de Guy III de Levis maréchal de Mirepoix. En 1323, Marguerite, dame de Chateron, veuve de Pierre Choisel vendit la moitié de la seigneurie du Tremblay à Jean Mignon, archidiacre de Blois et clerc de la chambre des comptes ainsi que 2 fief tenus par Guillaume Bagot, chevalier et seigneur de Pontchartrain dans la mouvance de Maurepas et de Chevreuse. En 1330, Guillaume de Chateron vend l'autre moitié de sa seigneurie du Tremblay au même Jean Mignon. Jean Coquatrix, bourgeois de Paris rend aveu à Jean Mignon pour les 2 fiefs du Tremblay mouvants de la Hunière et de Pontchartrain. En 1341, Robert Mignon fait hommage à Robert de Villepreux. Vers 1440, la terre du Tremblay passe à la famille Leclerc qui possédait déjà la chatellenie de Neauphle et le manoir de Couperville. En 1577, Jean Leclerc, seigneur du Trembay fait hommage au duc d'Anjou comme seigneur de Neauphle le Château. Enfin la seigneurie passe dans les familles d'Angennes et de Vérac. Au moment des guerres de Religion, Marie de Lafayette, dame du Tremblay, fait construire un mur pour mettre à l'abri les maisons qui s'élèvent le long de son domaine. Un château édifié à la fin du XVIe siècle par Jean Leclerc est terminé par son épouse Marie de Lafayette. Cette dernière fait construire une poterne à pont-levis pour mettre le château en sûreté. L'un de leur fils François se fait capucin sous le nom de père Joseph et devient conseiller de Richelieu. Son frère Henri, gouverneur de la Bastille entreprend des travaux et donne au château son aspect quasi-actuel. Au XVIIIe siècle, deux ailes basses en retour sont adjointes. Le château est vendu en 1947 à la ville de Neuilly-sur-Seine ; redevenu propriété privée, il est réutilisé pour des activités hôtelières et de loisir.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.LA HUNIERE: Le château fort
1-1) Le site
Site fortifié de forme rectangulaire de 70m de côté, entouré d'un fossé dont on devine les contours et visible sur le pourtour d'une petite motte de forme circulaire. Sur la motte on voit les restes d'un donjon circulaire d'environ 10m de diamètre aux murs épais de 2m. L'enceinte haute encore de 6m a une épaisseur de 2,60m, on voit encore une poterne (amorce d'arc) et une tour contrefort pleine de 3m de diamètre.
1-2) Le donjon circulaire
Le donjon de forme circulaire est conservé sur les 3/4 de sa circonférence, il possède des murs haut d'environ 1,50m (hors dégagement) pour une épaisseur de 2m.
1-3) la chemise
A la pointe extrème de la motte, on voit les restes d'une chemise d'une forme ovale voir circulaire, conservée que sur un côté.
1-4) L'enceinte castrale
1-5) La motte castrale
Motte castrale de faible hauteur, à peine visible.
1-6) La Poterne
Poterne ou porte principale de la haute cour, défendue par une tour circulaire type contrefort plein. Cette porte possède encore des restes de son coffrage au niveau de son arche.
1-7) La tour pleine
1-8) La bayle
1-9) Les fossés
2.GARANCIERES
2-1) Le site
Le village est mentionné dès 800, dans le polyptyque de l'abbé Irminon, sous le nom de Warencera ; pour autant, le développement de l'agglomération s'avère lent. Dans ce petit bourg rural, un artisanat, la fabrication de peignes, s'est implanté. Garancières ne profite pas de la présence de Henri IV dans la région ; ayant refusé de fournir subsistance, blé et fourrage à la troupe cantonnée à Montfort-l'Amaury, le village est indirectement sanctionné : ses plus riches habitants taxés, la somme allant récompenser ceux qui ont soutenu le roi.
Warentice, Garencières et enfin Garancières a été la seigneurie d'Ansold de Garancières en 1156, qui donna au couvent de Cernay sa terre de Plaisir. En 1168 c'est Isnard de Garancières le propriétaire. Dépend de Montfort l'Amaury en 1556.
Blasonnement : d'azur à la tour d'or chargée d'une quintefeuille de gueules
2-2) Le manoir le Fresnay
La tour du Fresnay, gros bâtiment circulaire érigé au milieu des champs, est en fait un vestige du manoir du même nom, détruit à la fin du XIXe siècle. Elle correspond au colombier du domaine, ainsi qu'en témoignent les boulins qui subsistent à l'intérieur. Au Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle, les pigeons constituent un mets très apprécié sur les tables des seigneurs ; de plus, leurs déjections appelées « colombine » sont un engrais naturel prisé, riche en azote.
2-3) Le château de Breuil
Le château du Breuil est d'abord un pavillon de chasse du prince de Léon. Henri IV, qui revient blessé de la bataille d'Ivry en mars 1590, y séjourne. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs parties de l'édifice sont agrandies. Le château appartient sous l'Empire au général Mallet, qui tente un coup d'état pendant la campagne de Russie. Des années plus tard, il est la propriété de la famille de Rohan, qui vient y passer à la fin du XIXe siècle la période de Noël et organise des fêtes. En 1967, le château, abandonné depuis vingt ans, est racheté et diverses salles de réception y sont aménagées.
La ferme du Breuil dépendait autrefois directement du château du même nom. En effet, l'exploitation agricole, accolée au château, subvenait grâce à la diversité de ses activités agricoles aux besoins de ses occupants.
3.GROSROUVRE
3-1) Le site
Différents sites de la forêt d'Iveline, essartés par les moines au Moyen Âge, forment des clairières propres à la culture autour desquelles se fixe l'habitat ; celui-ci donne ensuite naissance à des fiefs. C'est ainsi que se développe Grosrouvre, regroupant en paroisse vers le XIIe siècle un certain nombre de domaines comme Moisan, le Chêne-Rogneux, la Troche, la Malmaison, la Mandreuse et Marcilly, auxquels s'ajoutent des hameaux tels les Haizettes, les Aubris, la Surie, le Buisson. Cette configuration perdure aujourd'hui. Le fief le plus important est le Chêne-Rogneux qui, depuis Guérin en 1230, est cité bien des fois comme ayant cour de justice au lieu-dit « La Cour de l'Orme ». Diane de Poitiers est dame du Chêne-Rogneux au moment où Henri II construit un château à Saint-Léger. La situation de Grosrouvre, dans les collines et vallons coupés de bois, a attiré nombre d'artistes, peintres, écrivains. Le village, devenu très résidentiel, ne comporte plus que deux ou trois fermes. A gauche de l'église, on peut voir Le Manoir de "Vauruisseaux", ancienne demeure des Seigneurs de Grosrouvre aux XV-XVIème siècles, et dont les seuls vestiges sont quatre tours rondes. La maison d’habitation, dominée par la souche en brique d’une énorme cheminée à fronton, est d’une construction plus récente. La Ferme de Moisan est un ensemble particulièrement pittoresque. A l’extérieur, deux mares ajoutent au charme de la façade du corps de logis.
3-2) Le Manoir du Chêne Rogneux
3-3) Le Manoir de Moisan
La ferme de Moisan est le siège d'un fief qui appartient notamment à la famille Barat, dont plusieurs membres occupent d'importantes charges à Montfort-l'Amaury au début du XVIe siècle. Les Barat offrent un vitrail à l'église de cette ville, sur lequel ils sont représentés en donateurs au premier registre. Au centre même de la ferme de Moisan, subsiste un pigeonnier de plan hexagonal. L'édifice entre dans la catégorie des pigeonniers-tours. Une cheminée ajoutée ultérieurement semble indiquer qu'une autre fonction est assignée à la construction, à une période indéterminée.
3-4) Le Manoir seigneurial de "Vauruisseaux"
3-5) Le Manoir de la Troche
4.SAINT REMY l'HONORE
4-1) Le site
Le village domine une plaine maraichère et de grande culture, mais à ses pieds, au creux d'un vallon ombreux, coule la rivière de la Mauldre sur les berges de laquelle s'élèvent des moulins. La forêt n'est pas loin, avec le site gallo-romain du Parc aux Anglais, double souvenir d'occupation dont le second évoque la guerre de Cent Ans. Sanctus Remigius, Saint Remi était une ancienne abbaye de femmes de l'ordre de Saint Benoit, ayant Saint Rémy pour patron. Saint Rémy a eu pour seigneurs: Rogerius de Sancto Remigio et Acho de Sancto Remigio au XIIs.
Blasonnement : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois croisettes d'or.
4-1) Le parc des Anglais: Château fort
En rebord de plateau, à quelques kilomètres à l'ouest du village, subsistent les vestiges d'une imposante enceinte de terre cernée de fossés. De plan pratiquement carré, elle couvre environ un hectare et demi. Les talus de l'enceinte atteignent en moyenne trois à cinq mètres de hauteur, à quoi il faut ajouter entre deux et trois mètres de profondeur pour les fossés. Trois entrées symétriques permettent l'accès à l'enclos, au nord, au sud et à l'ouest. La découverte de nombreuses tuiles et céramiques gallo-romaines, lors de sondages dans les années 1930, ainsi que l'organisation générale du site suggèrent l'existence d'un établissement militaire antique semi-permanent, dont la date et le rôle exacts restent à déterminer.
4-1) Le prieuré de Notre Dame des Hautes Bruyères
La grange à échauguette située dans l'enclos extérieur faisait autrefois partie des bâtiments de la ferme. Elle constitue la tour de guet du prieuré Notre-Dame-des-Hautes-Bruyères. La façade de l'ancienne grange médiévale surmontée de cette tour brûle en 1877. Une statue de Saint Louis est insérée dans la tourelle. Légèrement incisée dans la pierre, la Vierge assise est placée depuis le XVIIe siècle sur le tympan de l'entrée de la grange. Elle-même est encadrée par une architecture rappelant à nouveau celle d'un tympan. Encastrées dans la pierre, les armoiries du prieuré représentent un écusson où figurent trois fleurs de lys. Elles couronnent au XIIIe siècle l'entrée au monastère royal.
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Magny les Hameaux, fief des Marly-Châteaufort
MAGNY les HAMEAUX
BULOYER - PORT ROYAL-LEVIS st NOM- BRETEUIL-SENLISSE-VOISINS le BRETONNEUX
Les Donjons circulaires du XIIs, Tome I
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La commune est située à environ 12 km au sud-sud-ouest de Versailles et à 23 km au nord-est de Rambouillet. Outre le village (Magny-Village), coeur historique de la commune, le territoire comprend aujourd'hui sept hameaux : le Bois des Roches, Buloyer, Romainville, Brouessy, Villeneuve, Gomberville et Cressely.
Magny correspond à un archétype fréquent en France dont les formes anciennes sont du type Maniacum ou Magniacum, nom de domaine gallo-romain composé avec le suffixe -acum de propriété et le nom du propriétaire Manius « né le matin » ou Magnus « le Grand ». Ces noms latins étaient bien sûr portés par des personnages d'origine gauloise. La commune s'est appelée « Magny-l'Essart » jusqu'en 1788, date à laquelle elle a pris son nom actuel.
Le château fort, situé au coeur même du village, date de la fin du XIe siècle. Le village de Magny-l'Essart, son nom au XIIs, dont la seigneurie appartient aux seigneurs de Châteaufort. Mathilde, leur héritière au milieu du XIIs apporta la chatellenie par son mariage à Bouchard I de Marly dont le père, Mathieu avait fondé en 1215 l'abbaye de Port-Royal (Porrois). En 1356, la famille de Levis devint propriétaire de la seigneurie et ceux jusqu'au début XVIIs. Le château est fortement détruit au cours des guerre de cent ans (1337-1453). Au XVIIs, la famille des Escoubleau s'en porta acquéreur et en 1675, le fief fut réuni au duché de Chevreuse avant d'être remis en 1693 aux dames de Saint Cyr, baronnes de Magny-l'Essart. Il est cité en ruine dès le début du XVIIIe siècle, d’ou son état actuel, il est aujourd’hui intégré au jardin d’une propriété privée non ouvert au public. De la forteresse du moyen âge, il ne reste que quelques pans de mur, en gros moellons de meulières, base d’une tour et quelques pierres taillées, campées sur une butte de terre. Bien qu’il ne soit guère envisageable de restaurer un tel monument, il serait bon de conserver les traces de ce que fut jadis une forteresse ou de veiller à ce qu’elles ne disparaissent à jamais.
La commune est surtout marquée par l'histoire de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs (à l'extrême ouest du territoire communal) qui accueillit des religieuses cisterciennes et fut un haut-lieu du jansénisme jusqu'en 1709, date de l'expulsion des religieuses par Louis XIV.
Les armes des CHATEAUFORT-MARLY se blasonnent ainsi : écartelé, au premier et au quatrième d'or à trois aiglettes de sable, au deuxième d'azur à une chapelle d'argent ombrée de pourpre, au troisième d'azur aussi à une gerbe de blé d'or accompagnée d'un arbre de sinople en pointe
Les armes de Marly-le-Roi se blasonnent ainsi : écartelé, au premier et au quatrième d'azur au soleil d'or, au deuxième et au troisième d'or à la croix de gueules treillissée d'argent et cantonnée de quatre aiglettes d'azur
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.MAGNY LES HAMEAUX: Le château fort
1-1) Le site
Etude de 1899 : "Depuis cette époque, la tour délaissée s’est écroulée et aujourd’hui on ne voit plus que les vestiges de ses murailles éventrées encore hautes de 9 mètres extérieurement et de 4,5 intérieurement", large de 2 mètres. Ces ruines, toute couvertes de lierre ont un diamètre intérieur de 11 m. La tour avait donc une largeur de 15 mètres et à peu près une hauteur de 20 mètres (60 pieds).Elle fut donc plus élevée que celle qui existe encore à chevreuse. Ses dimensions la rapprochent plutôt de la tour de Maurepas."
Du château médiéval de Magny-l'Essart, siège d'une seigneurie mouvante de Châteaufort, reste principalement derrière l'église, une motte coiffée d'une large tour polygonale, presque circulaire à l'intérieur. Les pans de murs qui en subsistent sont irrégulièrement étayés de contreforts et offrent deux départs de courtines qui délimitaient l'enceinte castrale proprement dite. L'archaïsme de ce donjon invite à le dater du premier tiers du XIIs, même période que châteaufort. Ce donjon haut d'environ 9m pour un diamètre de 14,60m est conservé sur une bonne moitié de sa circonférence. Il comporte encore 3 contreforts fins et plats et ses murs sont epais d'environ 2m. Les planchers des différents étages devaient être soutenus par un pilier central comme à Maurepas.
1-2) Le donjon circulaire
a) L'extérieur
b) L'intérieur
1-3) L'enceinte castrale
1-4) La motte castrale
1-5) La chapelle castrale Saint Germain
Avec le cimetière et le donjon, cette église du XIIs constitue le c'ur du village ancien de Magny. Le portail avec les colonnettes à chapiteaux sculptés de feuilles d'eau et le tympan couvert d'un arc brisé sont un décor peu fréquent pour une église rurale. Le collatéral sud, édifié au XVe siècle, est de style gothique flamboyant. Le choeur est reconstruit au XVIIe siècle, ainsi que les voûtes de la nef. La cuve baptismale, le bénitier, les boiseries, le maitre-autel du choeur ainsi qu'une trentaine de dalles funéraires proviendraient de l'abbaye de Port-Royal. Cette église est la seule, avec celle de Voisins-le-Bretonneux, à être encore entourée de son cimetière.
Cette dalle représente un couple les mains jointes. Il s'agit sans doute de seigneurs de Magny-les-Hameaux. L'église Saint-Germain comporte plusieurs dalles funéraires dont certaines remontent au XIIIe siècle. Elles abritent les dépouilles de religieux de Port-Royal ou de seigneurs locaux comme Bouchard IV de Marly, Marguerite de Lévis ou Jehanne de Chevreuse.
1-6) La Porterie
2.Abbaye de Port Royal
2-1) Le site
L’abbaye de Port-Royal est fondée en 1204 par Mathilde de Garlande. Apparentée aux familles royales de France et d’Angleterre, celle-ci décide de créer cette abbaye avec des fonds que son mari Mathieu de Marly, partant pour la quatrième croisade, a mis à sa disposition pour des œuvres pieuses. Son choix se porte sur un lieu peu éloigné de l’abbaye des Vaux-de-Cernay, abbaye masculine. Elle souhaite, pour sa part, fonder un monastère féminin. Le lieu s’appelle « Porrois » et abrite déjà une chapelle dédiée à Laurent de Rome. Le site de Porrois est marécageux et boisé. Son nom viendrait des poireaux sauvages qui y poussaient. Par la suite, le nom s’est transformé en « Port-Royal » en raison de l’appui que lui ont apporté les rois de France, tels Philippe-Auguste puis Louis IX, de même qu’Odon de Sully, évêque de Paris. L’abbaye est donc dès ses débuts liée au pouvoir royal. L’abbaye est au départ considérée comme une simple extension féminine des Vaux de Cernay, comme un prieuré dépendant de ce monastère, c’est-à-dire dépourvue d’autonomie hiérarchique, financière et d’autorité. De même qu’aux Vaux de Cernay, les religieuses de Port-Royal adoptent la règle de saint Benoît en y adjoignant les grands principes de l'ordre des cisterciens. Les premiers directeurs spirituels viennent également de l’abbaye voisine. Mais en 1214, à la suite de trois prieures, une première abbesse est élue. Elle s’appelle Éremberge. Port-Royal gagne ainsi son autonomie et un véritable statut d’abbaye. Cependant son importance est numériquement faible : autour d’Éremberge, la communauté ne compte qu’une douzaine de membres. En 1223, le pape Honorius III lui accorde le privilège de célébrer la messe même en cas d’interdiction dans tout le pays. Même si les premières religieuses viennent de monastères bénédictins, Port-Royal prend très vite une orientation cistercienne. Le site est typiquement cistercien : Port-Royal se trouve au fond d’un vallon fermé, parcouru par une rivière, le Rhodon. Le vallon est barré en son fond pour créer des étangs, ce qui favorise l’utilisation de la force hydraulique. Cet emplacement répond au désir de Bernard de Clairvaux d’inciter à l’humilité et à la vie intérieure par un retrait du monde. Les fréquentes visites des généraux de l’ordre cistercien laissent penser que Port-Royal s’est inscrit très tôt dans l’orbite cistercienne.
L’architecture est caractéristique de l’ordre cistercien. Dès la fondation de l’abbaye en 1204 et la construction des premiers bâtiments, comme la partie conventuelle achevée en 1208, l’appartenance de Port-Royal à l’obédience de Cîteaux, évidente dès ses débuts même si elle n’est officielle qu’en 1240, décide de l’organisation générale du lieu. La seule élévation est celle du clocher de l’église, qui est terminée en 1229. Le cloître est adossé au côté sud de l’église, comme dans la plupart des abbayes cisterciennes. Le chapitre et le réfectoire, lui-même surmonté du dortoir, forment le côté est du cloître, dans le prolongement du transept. L’église est construite sous la direction de Robert de Luzarches, architecte de la cathédrale d’Amiens, engagé et rémunéré par les Montmorency. Son plan suit également la tradition architecturale cistercienne : l’église a une forme de croix latine à base carrée, dont le tracé ne comporte que des lignes droites se coupant en angle droit. L’édifice comprend une nef de six travées flanquée de bas-côtés, et sa longueur totale est de 55 mètres. Le transept saillant est large de 28 mètres. Le sanctuaire est assez court (seulement deux travées) et se termine en chevet plat. Ceci s’explique par la tradition cistercienne, où le chœur des moines et des moniales n’est pas placé après la croisée du transept mais dans la nef centrale. À Port-Royal, le chœur occupe les troisième, quatrième et cinquième travées, et se termine par une grille. Les gravures montrent que l’église est élevée à trois niveaux dans un style gothique archaïque, avec de grandes arcades en arc brisé. Cependant, malgré l’emploi de voûtes sur croisées d’ogives, renforcées à l’extérieur par des arcs-boutants, l’église ne comporte que des fenêtres hautes, de petite taille et en plein cintre, sans doute par volonté (là encore typiquement cistercienne) d’humilité. Les arcs de la voûte reposent sur d’épaisses colonnes simplement ornées de feuillages sculptés.
Les aménagements ultérieurs, assez peu nombreux, ont lieu essentiellement au XVIe siècle sous l’impulsion de l’abbesse Jeanne II de La Fin (1513-1558), qui fait réparer l’église et reconstruire partiellement le cloître, le dortoir et l’infirmerie. Le chapitre est alors déplacé dans le bras droit du transept dont la grande arcade est murée. C’est également à cette époque que sont installées dans le chœur des stalles et des boiseries sculptées, considérées comme « fort belles » deux siècles plus tard, lorsqu’elles sont vendues aux Bernardins de Paris avant la démolition de l’église. Ces boiseries ont disparu à la Révolution. La deuxième vague de restauration se situe au milieu du XVIIe siècle, à partir du retour des religieuses aux Champs en 1648. Malgré les travaux de drainage des Solitaires, l’église est régulièrement inondée par les eaux qui dévalent du plateau des Granges. L’abbesse Angélique Arnauld décide donc de faire surélever de sept pieds (environ 2,30 m) le sol de l’église. Ces travaux enlaidissent l’ensemble, puisque les chapiteaux arrivent alors à hauteur de tête, ce qui prive l’église de son harmonie. Mais cela ne dérange pas l’abbesse, pour qui seule la prière compte, et qui dit : « J’aime par l’esprit de Jésus-Christ tout ce qui est laid », préférant que l’argent aille aux pauvres plutôt qu’à l’ornement de l’église. Dans ses lettres, elle fustige d’ailleurs les Carmélites qui embellissent leurs couvents.
Port-Royal devient l’une des plus puissantes abbayes du bassin parisien. Elle tire ses ressources de la possession de terres agricoles et forestières aux alentours et sur des terroirs plus éloignés. Les religieuses ont rang de seigneurs sur la plupart de leurs terres, on les appelle les « dames de Port-Royal ». Elles ont l’intégralité des droits seigneuriaux et reçoivent « foi, hommage, aveux et dénombrement »On évalue le patrimoine principalement de par le partage qui a lieu en 1669 entre l’abbaye des Champs et celle de Paris, lorsque celle-ci reçoit son autonomie (voir infra). La singularité de Port-Royal vient du fait que les religieuses ont converti en rentes une grande partie de leurs biens. Elles ont progressivement transformé ces rentes en prêts, ce qui fait que le monastère fonctionne comme une banque. En plus de la propriété originelle du vallon de Port-Royal, les religieuses reçoivent par don, au cours du XIIIe siècle, celles de Magny, Champgarnier, Germainville, Launay et Vaumurier, situées sur la paroisse de Saint-Lambert des Bois, donc juste autour de l’abbaye.
En 1230, les religieuses reçoivent des terres à Villiers-le-Bâcle, puis en 1479 à Buc et Châteaufort, et enfin à Buloyer en 1504, ce qui permet d’augmenter les revenus fonciers. L’abbaye se met alors à acheter des fermes plus éloignées. Elle en reçoit aussi comme dons pieux. C’est ainsi qu’en 1258 un seigneur, Jean de Montfort, fait don de sa forêt et de 240 arpents de terre au Perray en Yvelines, à douze kilomètres à l’ouest de Port-Royal. Au sud et à l’ouest du monastère, les seigneuries de Gourville et de Voise s’ajoutent également au patrimoine pendant le Moyen Âge. Au XVe siècle, l’abbaye entre en possession d’une importante seigneurie, celle de Mondeville, à 35 kilomètres de distance, entre Melun et La Ferté-Alais. Elle y détient les droits de haute, moyenne et basse justice, ainsi que le droit de notariat. Port-Royal est donc extrêmement riche. Lors de la séparation des deux monastères en 1669, environ un tiers des terres est dévolu au couvent parisien, le reste demeurant en possession de celui des Champs.La richesse matérielle de l’abbaye, fondée sur le foncier, est extrêmement dépendante des aléas politiques. Malgré un patrimoine important dès ses débuts, les périodes de troubles causent des pertes de richesse conséquentes qui entraînent un déclin du monastère à la fin du Moyen Âge. Connaissant un rapide développement à ses débuts, l’abbaye entre ensuite dans une période de relatif déclin. La guerre de Cent Ans est particulièrement destructrice pour Port-Royal, les épidémies se succèdent, l’insalubrité, la baisse des vocations et des difficultés économiques laissent croire un temps à la fermeture du monastère. En 1468, l’abbesse Jeanne de La Fin parvient cependant à récupérer les biens et les terres perdues dans le chaos de la guerre. En 1513, elle démissionne en faveur d’une de ses nièces, Jeanne II de La Fin, qui poursuit les travaux de restauration : l’église est embellie, le cloître et les autres bâtiments sont rénovés. Au XVIe siècle, commence à se poser un problème de moralité parmi les religieuses. Le premier à s’en préoccuper est Jean de Pontallier, abbé de Cîteaux. En décembre 1504, il effectue une visite à Port-Royal et organise une restauration matérielle. Choqué par ce qu’il y voit, l’abbé dénonce le peu de piété des moniales, qui expédient le plus vite possible les prières et font preuve d’un mauvais état d’esprit, selon lui. Les manières cavalières des résidentes de Port-Royal ne semblent pas s’arranger avec le temps, car à la fin du XVIe siècle, un de ses successeurs, Nicolas Boucherat, remarque au cours d’une visite de l’abbaye que les religieuses y sont « coutumières de prendre noise, de dire injures atroces, sans avoir égard au lieu et à la compagnie où elles sont ». Il leur recommande de respecter le silence et de recommencer à pratiquer les aumônes à la porte du monastère. Port-Royal contrôle les terres et des forêts dans un rayon de huit kilomètres. Les deux fermes qui constituent sa principale source de richesse sont celles des Granges et de Champgarnier. Au cours du XVIe siècle, le monastère acquiert autour de Nanterre de vastes propriétés qui lui fournissent des rentes considérables. En 1659, l’abbaye achète la terre et la seigneurie de Montigny, puis d’autres domaines à Voisins-le-Bretonneux et Trappes. Au terme de ces acquisitions, le territoire de l’abbaye touche au parc de Versailles, ce qui peut représenter un motif de dissension avec le roi, notamment sur la question du contrôle des sources. À partir de la fondation du monastère de Port-Royal de Paris, les religieuses achètent également des maisons dans la capitale, situées dans le faubourg Saint-Jacques. Elle fut détruite en 1711, de même que l’abbaye, sur ordre de Louis XIV. Aujourd’hui, il n’en subsiste que les fondations qui furent remises à jour après la Révolution.ont été remises à jour après la Révolution par le duc de Luynes.
2-2) Les ruines de l'abbatiale
De l'ancienne abbaye de Port-Royal des Champs ont été conservés les bâtiments réutilisés pour l'exploitation agricole, principalement l'ample pigeonnier et l'ancien moulin. Les fondations de l'abbatiale de l’église abbatiale de Port-Royal des Champs fut édifiée au XIIIe. Un petit oratoire néo-gothique a été ajouté à la fin du XIXe siècle à l'emplacement du chevet, pour accueillir le premier musée.
2-3) La ferme des Granges
La ferme des Granges, située sur le plateau, fut rattachée dès 1709 à Port-Royal de Paris. Vendue à la Révolution, elle est restée en activité jusqu'en 1984, date de son achat par l'Etat. On peut encore y voir l'ancienne grange à blé et un ensemble de bâtiments agricoles des XVIIe et XIXe siècles. Au centre de la cour se trouve encore le puits dit de Pascal.
2-4) Le Pigeonnier
La porterie, les bâtiments de service, le bâtiment des hôtes, la maison du chapelain…étaient situés à proximité du cloître de l’abbaye. Seuls demeurent aujourd’hui les ruines de la porterie, le pigeonnier du XIIIe siècle et le moulin à l’ouest de l’église, un pigeonnier, toujours visible aujourd’hui, est édifié au XIIIe siècle.
2-5) La Porterie
La porterie, les bâtiments de service, le bâtiment des hôtes, la maison du chapelain…étaient situés à proximité de la clôture. Seuls quelques éléments de l’ancienne porterie (piédroits médiévaux et porte piétonne) demeurent dans les ruines de l’ancienne ferme construite au XIXe siècle.
2-6) Le Mur d'enceinte
Les abbayes sont séparées du monde par un mur d’enceinte dit « la grande clôture ». Ce mur a été rehaussé et fortifié par des tours carrées au moment de la Fronde (1648-1652) pour défendre l’abbaye. Seuls quelques vestiges subsistent encore aujourd’hui. L’ancienne route royale, qui longeait l’enceinte de l’abbaye, a été transformée en chemin de randonnée dès 1938, sous le nom de « Chemin Racine ».
3.BULOYER, le manoir seigneurial
3-1) Le site
Buloyer, l'un des hameaux de la commune de Magny les Hameaux sur la route de Port Royal, possède un château mentionné dès le XVIIe siècle, dans lequel les reliques de saint Quentin, martyr de Picardie ont été cachées, afin d’être préservées des destructions des guerres de religion. Relevant de Villepreux, le fief appartient en 1757 à M. Gallot, seigneur de Mesle. À la fin du XIXe siècle, le manoir est transformé en exploitation agricole. Restauré en 1967 par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui en occupe une partie - l’autre étant réservée à un usage agricole. La ferme-manoir dont les premiers bâtiments pourraient remonter au XVs, ce site comprend une chapelle du XVs, des logis XV-XVIs comportant des fenêtres à meneaux (bouchées), des bâtiments d'exploitation et des restes de douves. D’autres bâtiments, dont une tour carrée donnant sur l’ancien parc, ont été construits au début du XVIIs.
3-2) L'enceinte
3-3) La tour ronde XV-XVIs
3-4) Les logis XV-XVIs
3-5) La chapelle castrale
3-6) Les communs
3-7) Le pavillon XVIIs
4.CHOISEL, le Châteu de Breteuil
4-1) Le site
Le château situé à l'emplacement du château de Breteuil s'appelait à l'origine Bévilliers ou Buvilliers, sans doute parce qu'en ce lieu s'élevaient, à l'époque gallo-romaine, deux villas (bis villae). La seigneurie est mentionnée pour la première fois en 1142 et dépendant de la châtellenie de Chevreuse, la première référence à un manoir remonte à 1560. Cette terre est inféodée à la seigneurie de Chevreuse de 1204 au XIVe siècle et confiée à l'une de ses branches collatérales. En 1228, Guy IV, châtelain de Chevreuse, charge le seigneur de Choisel de le remplacer pour conduire l'évêque de Paris à la cérémonie d'intronisation. Un autre seigneur de Choisel accompagne Saint Louis lors de sa dernière croisade. En 1373 la terre de Choisel est cédée à Pierre, seigneur de Chevreuse. Le château appartient alors à la famille Le Jay. On estime généralement que c'est dans les années 1580, que Nicolas Le Jay (mort en 1585) fait exécuter d'importants travaux qui donnent au logis son plan actuel. Selon d'autres historiens, ceux-ci seraient dus à Thibault Desportes, grand audiencier de la Chancellerie de France, qui achète le domaine par adjudication en 1596. En 1602, Thibaut Desportes achète le domaine, fait construire un nouveau château en pierre et brique et aménage le parc. Le domaine entre dans la famille de Breteuil en 1712. Lors de la Révolution, le château est pillé. Sous la Restauration, la terre de Bévilliers prend le nom de Breteuil. L'ensemble est restauré à la fin du XIXe siècle par Joseph de Breteuil mais c'est le huitième marquis, Henri (1848-1916) qui donne à l'édifice son aspect actuel et fait de sa demeure un lieu de prestige où se réunit l'aristocratie de l'époque. À la fin du XIXe siècle, les paysagistes Henri et Achille Duchêne dessinent des jardins à la française. Un important programme de restauration du château, de l'orangerie, du pigeonnier, des jardins et du parc est engagé en 1967. Commune essentiellement agricole aux XIXe et XXe siècles, Choisel est constituée du village et des hameaux d'Herbouvilliers et de La Ferté.
De la forteresse médiévale, seuls subsistent les fossés et le colombier. Le château ainsi construit comporte une cour carrée, entièrement enserrée de murs ou de constructions et bordée de fossés. Sur l'avant, deux pavillons d'angle (qui existent toujours mais ont été surélevés) et un corps de passage central commandé par un petit pont-levis ; en fond de cour, sur toute la largeur, un grand bâtiment dont le corps central a été conservé sans beaucoup de modifications. Les bâtiments sont à structure en brique et remplissage sous enduit.
Ce colombier est un vestige de la forteresse médiévale de Bévilliers. Le bandeau de pierre horizontale qui interrompt la surface uniforme des murs est destiné à empêcher les rongeurs d'atteindre les lucarnes d'envol.
5.LEVIS Saint Nom
5-1) Le site
Les comtes de Lévis-Mirepoix, seigneurs de Lévis-Saint-Nom, avaient reçus du roi de France le fief du château de Montségur (Ariège) occupé par les Cathares. Après la prise du château en 1244, la possession du pog revint à Guy II de Lévis, seigneur officiel de Mirepoix depuis le traité de 1229. C'est sa famille qui bâtira l'actuel Château de Montségur.
Mentionné pour la première fois dans un diplôme de Charlemagne, en 774, Lévis prend ensuite l'appellation de Lévis-Saint-Nom, du nom d'un vicaire épiscopal venu dans la commune. Les seigneurs de Lévis se caractérisent par la fondation de plusieurs établissements religieux, en particulier le prieuré Saint-Pierre au XIIe siècle et l'abbaye Notre-Dame-de-la-Roche. En 1721, Lévis est rattaché pour six ans au domaine royal, puis revient au comte de Toulouse. Le village se caractérise par un habitat dispersé composé d'une vingtaine de hameaux dont Girouard est le plus important. L'activité économique de Lévis-Saint-Nom, essentiellement agricole, est constituée par l'horticulture, la culture de céréales et l'élevage.
- Un château fort fut construit au XVIe siècle au lieu-dit Le Marchais, restauré au XVIe siècle puis vendu en 1721 au comte de Toulouse, Louis Alexandre de Bourbon, qui le fit détruire en 1727; le site a été classé en 1980.
- Le château de La Cour Lévis, au lieu-dit La Cour, a été construit à la toute fin du XIXe siècle à l'emplacement d'un château de la fin du XVIIIe siècle détruit; il n'est pas inscrit aux monuments historiques.
- Abbaye Notre-Dame-de-la-Roche sur la route menant au Mesnil-Saint-Denis : fondée par Guy Ier de Lévis vers 1196, cet abbaye date du début du XIIIe siècle et les logis et communs du début du XVIIe siècle; l'ensemble a été inscrit aux monuments historiques en 1926 et abrite aujourd'hui un centre éducatif et de formation professionnelle.
Les armes de Lévis-Saint-Nom se blasonnent ainsi : D'argent à trois chevrons d'azur. Ce blason dérive de celui de la famille de Lévis, D’or à trois chevrons de sable
5-2) Le prieuré Saint Pierre
Remplaçant un prieuré de bénédictins fondé au IXe siècle, cet établissement est détruit au XVIIIe siècle. Il ne subsiste que la chapelle du XIIIe siècle, utilisée au XVIIIe siècle comme grange puis transformée en maison d'habitation.
5-3) Le Manoir de la Recette
Le manoir tient lieu de logis au fermier du château médiéval, démoli par le comte de Toulouse au XVIIIe siècle. Il prend le nom de manoir de la Recette car le fermier est chargé de percevoir les revenus, ou recettes, du domaine. L'ensemble est flanqué, dans l'un des angles de la cour, d'un colombier transformé en habitation.
5-4) Abbaye Notre Dame de la Roche au Mesnil-Saint-Denis
Edifiée, selon une tradition populaire, pour abriter une statue de la Vierge déterrée miraculeusement par un taureau. En 1196, Guyon, curé de Maincourt obtint de l'abbé de Saint-Denis une terre écartée dit "La Roche" pour y fonder un ermitage en 1201.Puis s'y développa en 1226 une communauté de moines qui furent entretenus par Gui 1er de Lévis et devinrent chanoines réguliers de Saint-Augustin. En 1232, Gui 1er se distingua auprès de Simon de Montfort, dans la fameuse croisade contre les Albigeois, et fit par charte une donation pour construire là une abbaye dont Thibault de Marly (saint Thibault), abbé des Vaux-de-Cernay, surveilla l'édification. A partir du XIVe siècle, commence la décadence de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche, jusqu'alors prospère grâce aux seigneurs de Lévis.Les guerres, puis la Commende, causèrent la ruine presque totale de l'abbaye, tant qu'au XVIIème siècle, elle n'était plus qu'une chapelle dépendante des châtelains du Mesnil, la famille Habert de Montmor. Cependant jusqu'à la Révolution, elle demeura très fréquentée lors des pélerinages en l'honneur de la statue de Notre-Dame de la Roche. En 1809, suite au partage du domaine devenu bien national, la statue fut transférée à l'église de Lévis-Saint-Nom. Vers 1850, les Lévis-Mirepoix rachetèrent l'abbaye qu'ils restaurèrent et mirent à la disposition de l'orphelinat de l'Assomption d'Elancourt. Un siècle plus tard, des religieuses y créèrent une école de jardiniers, oeuvre poursuivie par l'actuel Centre professionnel horticole dont l'activité amine les lieux. Par ailleurs, messes et cérémonies religieuses sont régulièrement célébrées dans l'église. À la fin du XIIe siècle, Guy de Lévis reçoit le titre de maréchal de la Foi en raison de sa lutte contre les Albigeois. De retour à Lévis en 1226, il fait construire un monastère pour une congrégation relevant de la règle de saint Augustin. En partie ruinée à la fin du XIVe siècle, l'abbaye passe au comte de Toulouse puis à Louis XVI. Saisie comme bien national à la Révolution, elle est vendue à un fermier des environs puis rachetée après 1830 par les descendants des seigneurs de Lévis qui restaurent le domaine. Les Lévis-Mirepoix le mettent à la disposition de l'orphelinat de l'Assomption d'Élancourt. Depuis 1965, il abrite une école d'horticulture.
a) La Chapelle
Cette église abbatiale, résume l'art sobre, noble et pure du XIIIe siècle. Elle dessine une croix latine, dont le chevet carré est orienté vers l'Est, vers Jérusalem. La longueur de la nef est de 26 m x 7, celle du transept est de 20 m x 6, et la hauteur des voûtes est de 10 m. A l'intérieur se répand une excellente lumière grâce à la triple fenêtre du chevet, aux 15 fenêtres de 5 m 60 sur 1 m et à l'admirable rosace du portail. La construction de l'abbaye est surveillée par Thibault de Marly, abbé des Vaux-de-Cernay. À l'intérieur de l'église, les clefs de la voûte symbolisent la Trinité tandis que les retombées d'ogives reposent sur des culs de lampe représentant les vertus et les péchés capitaux dont l'orgueil, la colère, la luxure, l'envie et la gourmandise. Ce décor rappelle celui de la nef de la cathédrale de Bayeux.
b) Le Sanctuaire
On y retrouve les statues tombales de 3 maréchaux de la Foi, les seigneurs de Lévis. Celle de droite représente Gui II (+ 1260), celle de gauche Gui 1er (+ 1233), le fondateur de l'abbaye, et Gui III (+ 1299). A ses pieds, la dalle du jeune clerc Roger de Lévis (1313). Elle a été brisée à la Révolution par la chute de la statue de Gui III qu'un démolisseur voulait abattre. Il faillit être écrasé et fut si impressionné de l'incident qu'il en mourut, dit-on, quelques jours plus tard. Au centre, la dalle recouvrant les restes de Michel Humbert Chanut, mort en avril 1742 après avoir été abbé de la Roche pendant 47 ans, et avoir essayer vainement de redonner une certaine prospérité à l'abbaye. Un carrelage émaillé polychrome couvrait jadis le sol du choeur. Les carreaux du XIIIe siècle portaient pour les uns une fleur de lys, les autres les tours de Castille.
c) L'autel
Avec sa table en pierre qu'orne une guirlande gracieuse, il est de l'époque de l'abbaye. Il était en 1789, surmonté de l'authentique statue miraculeuse de Notre-Dame de la Roche, aux visages et aux mains de marbre (XIVe), qui, rachetée après la Révolution par le conseil municipal de Lévis-Saint-Nom, fut transportée avec son retable en bois sculpté, à l'église paroissiale en 1809 où elle domine le maître autel. Tout comme la "Vierge à l'Oiseau" de l'église du Mesnil, elle a participé en 1950 au Petit-Palais à Paris à l'Exposition "La Vierge dans l'art français".
d) Les stalles
Datant du XIIIe siècle, elles sont au nombre de 28 et sont parmi les plus anciennes de France. Les sculptures des miséricordes sont très simples mais les extrémités de chaque rang sont ornées d'un très beau décor architectural avec colonnettes et arcs trilobés. Leur moulage a été réalisé par le Musée des Beaux-Arts de Paris. La balustrade qui ferme le Choeur date du XVIe siècle. Elles comportaient autrefois des dossiers disparus sans doute au XVIe siècle, lorsque l'abbé Pierre de Bruges, fit élever la grille de bois de style Renaissance. Au nombre de trente, ces stalles s'appuient sur une clôture de choeur reconstruite pour l'abbé Pierre de Bruges au début du XVIe siècle. Figurant parmi les plus anciennes de France, elles sont réparties sur deux rangées et se caractérisent par leur décoration à feuillages et à motifs géométriques qui témoigne de la richesse de l'abbaye à cette époque.
Les autres éléments sculptés sont les culs-de-lampe dont la tradition y voit le symbole des Vices et des Vertus : Orgueil, Colère, l'Envie, la Luxure et la Gourmandise. Du côté de la nef les vertus cardinales : la Justice, la Force, la Tempérance et la Prudence aux trois visages.
e) Le transept
Il forme à gauche une chapelle mortuaire et le caveau de la famille Lévis Mirepoix. Plusieurs pierres tumulaires marquent des sépultures : Marguerite de Lévis, femme de Jean de Nanteuil (+ 1274), Isabelle, femme de Simon Foinet (+ 1294) de Neauphle-le-Château, Guy de Gastine, chanoine de Paris et son frère Jouffroy de Gastine, clerc (+ 1274), et Thimoléon Noncher, chapelain (+ 1788). Les 12 médaillons peints sur les murs et malheureusement presque effacés, représentaient les douze Apôtres. Le transept méridional se trouve prolongé par les lieux réguliers avec, à l'extrémité, le logis de l'abbé reconstruit au XVII par l'Abbé Pierre Habert, évêque de Cahors, mort en 1636. Il est d'ailleurs représenté sous les traits de Saint-Blaise accompagné de Saint-Denis, sur l'huile sur toile du XVIIe siècle qui embellit le mur du transept. Cette oeuvre funéraire représente l'un des premiers seigneurs de Lévis, Guy Ier de la Roche, décédé en 1233. Aux côtés de Simon de Montfort, il prend part à la croisade contre les Albigeois puis devient le principal donateur de l'abbaye. Sur sa stèle, il est représenté avec son bouclier, encadré par deux anges qui l'encensent.
f) Salle capitulaire
Des bâtiments abbatiaux, la salle capitulaire est le plus précieux vestige. Elle s'ouvrait sur la galerie orientale du cloître, aujourd'hui disparu, et faisait suite à l'ancienne sacristie. Elle comprend 6 travées, séparées par 2 colonnes octogonales, surmontées de chapiteaux au décor de feuillages. Les 6 compartiments de la voûte reposent sur croisées d'ogives et s'appuient sur ces colonnes et sur des culs de lampe appliqués aux murs. La cheminée monumentale n'aurait pas grand intérêt si ses jambages n'avaient pas été construits ou réparés au XVIIe siècle avec deux groupes de colonnettes jumelées provenant des galeries du cloître. Elle a été remise en 1958 dans son état primitif. Au-dessus de la salle du Chapitre se trouvait le dortoir.
6.SENLISSE
6-1) Le site
Le nom de Senlisse viendrait du latin Scindeliciae (Cordons brisés ?), nom qui apparaît en 862 lors du don du domaine à l'abbaye de Saint-Denis par Charles II le Chauve. En 1556, la châtellenie est réunie au duché de Chevreuse après l'échange qu'en fait le monastère avec le cardinal de Lorraine. Comme avoués de Saint-Denis, les châtelains de Chevreuse y exercent des droits féodaux. Il existe également dans la paroisse de Senlisse des terres seigneuriales : la Cour-Senlisse, la Barre, Malvoisine et les Bouillons.
Fin XVIe début XVIIe, il est fait état d'un fief et d'un seigneur de la Cour-Senlisse, dépendant de la châtellenie de Beaurain.
Le domaine est ensuite acquis par Claude de Lorraine, duc de Chevreuse durant le règne de Louis XIII et devient, en 1739, propriété de Charles Louis d'Albert, duc de Luynes.
En 1842, le duc de Luynes Honoré Théodoric d'Albert dote la commune d'une mairie et d'une école (deux bâtiments accolés) suivi d'une cantine.
6-2) Le Château de la Cour-Senlisse
Ancien manoir seigneurial mentionné dès le XIIIe siècle, ce château entouré de fossés remplis d'eau et cantonné de tours conserve son implantation rectangulaire d'origine. Il appartient en 1602 à Balthazar de Gouyn, puis est acquis par Claude de Lorraine en 1651. De 1739 à 1985, il est la propriété de la famille de Luynes. Le château de la Cour-Senlisse, classé monument historique, date des XIII-XVIIe siècle. Il est aujourd'hui propriété privée. Sur l'une des tours se trouvent les vestiges d'un chemin de ronde.
Ce colombier de pied surplombe la douve de la cour dont il occupe l'un des angles. La lucarne d'envol est située dans le lanternon qui couronne la toiture, et une ouverture est ménagée au sommet du toit pour permettre la communication entre l'intérieur et l'extérieur du colombier. La surface murale est ornée de bandeaux de brique.
6-3) Le Manoir du XIIIs
Un document des archives départementales signale l'existence de Malvoisine en 1210, époque importante de construction dans la région. Cette ferme fortifiée est reconstruite à la fin du XVe siècle, et les fossés et les murs sont à nouveau refaits en 1652. Le logis date des XVIe et XVIIe siècles. Longtemps indépendante, la seigneurie de Malvoisine est rattachée au domaine de Dampierre au XVIIe siècle. Malvoisine abrite au XXe siècle un haras où sont élevés des chevaux de selle français pour la compétition. Un centre équestre est adjoint à l'élevage.
7.VOISINS le BRETONNEUX
7-1) Le site
Le seigneur Pierre de Voisins prend part à la troisième croisade en 1191 et participe à la croisade contre les Albigeois en 1209. Il devient connétable de Carcassonne puis sénéchal de Toulouse. Ses enfants restent dans le Languedoc et sont à l'origine de familles très considérées dans la région. À la fin du XVe siècle, la seigneurie passe à la famille Gilbert, pour deux siècles. Elle est réunie au domaine royal en mars 1693. Le château devient de ce fait ferme royale. Voisins-le-Bretonneux reste un petit village agricole jusqu'à la fin des années 1960. La construction de l'aérodrome dit de Guyancourt, bien que situé presque entièrement rue Voisins, est la cause de nombreux bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. L'intégration de la commune dans la Ville Nouvelle explique l'explosion démographique de la population, qui passe de 320 habitants avant la Seconde Guerre mondiale à plus de 12 000 à la fin du XXe siècle.
Les armes de Voisins-le-Bretonneux se blasonnent ainsi :
D'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre croissants d'or.
7-2) Le Château de Voisins Decauville
Devenu propriété royale en 1693, le château de Voisins sert de logement au fermier. D'importantes restaurations sont effectuées au XIXe siècle et un bâtiment d'habitation est reconstruit. Le pigeonnier du XVIe siècle est conservé. Fortifiée, la ferme est entourée de fossés à fond de cuve et possède deux tours carrées d'angle. Les douves sont presque complètement comblées, et seule la portion des anciennes tours carrées est remise en eau et équipée d'une fontaine.
7.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Gazeran et Saint Léger en Yvelines, Montfort tome V
GAZERAN
Château fort de la forêt d'Yveline
SAINT LEGER- ORPHIN- RAMBOUILLET
La région entre Montfort et Rochefort tome V
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
Vaste commune rurale, largement boisée, Gazeran est incluse dans le massif forestier de Rambouillet. La commune est arrosée par la Guéville, petite rivière, affluent de la Drouette, qui prend sa source dans le parc du château de Rambouillet.
Jusqu'au XIVe siècle, le fief de Gazeran relève du comté de Montfort. Un château fort, autour duquel s'est développé le village, est bâti au XIe siècle sur le rebord du plateau qui domine la Guéville. En 1053, Amaury Ier, comte de Montfort, donne l'église et le presbytère au prieuré de Saint-Thomas d'Épernon. Le nom de la Commune a évolué avec le temps. Ce fut d'abord Waswing, preuve d'implantation des Francs. Elle est devenue Waswinganum puis Gaseren, Gaserent, Gasserend, et enfin Gazeran. Gazeran s'abritait au pied d'un château fort qui constituait un élément du système défensif des Montfort qui fut actif au XIème siècle. Les seigneurs de Gazeran sont connus dès le commencement du XIème siècle dans la personne d'Adelilme. Ce dernier fit élever son fils Amaury par les moines de Saint Evroult (Saint-Chéron) sur le prix de la dîme de Puseolis. Ce fils, devenu prêtre, donna à sa mort cette dîme à Sainte-Marie de Maule en 1076 selon le témoignage d'Orderic de Vitel. Thierry de Gazeran, l'un des plus grands seigneurs de son temps suivait le cours de Louis le Jeune et signa la charte de commune accordée à la ville de Compiègne avec Guy le Bouteiller de Senlis et Anseau de l'Isle. Simon de Gazeran figura en 1181 comme témoin des deux chartes du prieuré de Brethencourt, délivrées par Simon III de Montfort. Il signa jusqu'en 1213 beaucoup de chartes de Simon III. Sa fille se fit religieuse à Yerres et il donna à l'abbaye le moulin de Gazeran comme dot. En 1209, Mainier de Gazeran prend comme cens l'abbaye d'Yerres ce même moulin de Gazeran pour 6 muids de seigle et redevance annuelle et 20 sous parisis par an. Mainier, seigneur de Gazeran notifie que son fils Simon de Gazeran, chevalier, et son épouse ont ratifié la donation faite aux Vaux de Cernay par Mathilde, femme de Mainier de 1 muid de blé à prendre sur sa grange d'Ossonville ou Ouarville (Eure-et-Loir). Mainier donna aux Moulineaux (ancien prieuré de Poigny) 1 muid de blé sur le moulin de Gazeran. En 1226, Mainier ne vivait plus, Simon de Gazeran, chevalier donna aux Vaux de Cernay un demi-muid de blé à prendre annuellement sur sa grange d'Ossonville à la Toussaint de chaque année. Simon de Gazeran fut le bienfaiteur dla 'un grand nombre d'abbayes et de prieurés. Pour terminer une vie consacrée aux bonnes oeuvres, il se croisa avec Saint-Louis et finit son existence en Terre Sainte en l'an 1270, même année que celle de la disparition de Saintdomaines -Louis. La famille Simon resta en possession de Gazeran. En 1307, le châtelain de la maison de Saint-Priest (Eure-et-Loir), propriétaire de vastes près de Tours encourut la disgrâce du chapitre de Notre Dame de Chartres pour avoir appréhendé au corps un homme que les chamoines disaient de la famille Simonacquiert la . En 1394, l'héritier de Gazeran porta grâce à un mariage cette châtellenie avec celle d'Ouarville à la maison de Prunelay ou Prunelé (ancien château disparu d'Eure-et-Loir), originaire des Portes, près d'Etampes et en reste propriétaire du domaine jusqu'en 1653. La terre passe ensuite aux mains des Béthune, puis est achetée en 1708 par le comte de Toulouse, qui l'annexe à son Rambouillet. Il cessa de l'habiter et utilisa les pierres pour construire les communs du château de Rambouillet, qui en façade associe des chimères à un décor de feuillages. Cet ornement, relativement rare dans le canton, est vraisemblablement un remploi. Sur les ruines fut rétabli le château actuel au début du XIXème siècle par la famille Hache.
Blasonnement : De gueules à six annelets d'or posés 3, 2 et 1, au chef d'azur semé de fleurs de lis d'or, à deux cotices ondées d'argent brochant sur le tout du chef.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.GAZERAN
1-1) Le site
Le colombier XVIs est situé dans la bayle de l'ancien château, divisé par la route au XIXe siècle, dont la porte est surmontée d'une accolade de style flamboyant.
Cet édifice est construit au XIe siècle sur une hauteur qui domine le village par les premiers seigneurs de Gazeran, vassaux du comte de Montfort. Seul subsiste de ce site défensif l'ouvrage d'entrée bâti à la fin du XIIe siècle, qui constitue l'un des rares exemples de porte d'enceinte de type primitif. Il est constitué d'une tour carrée en saillie percée d'une porte équipée d'une herse et de vantaux. Un pont-levis est ajouté plus tard. Au XIVe ou au XVe siècle, les Prunelé font bâtir un logis, qui n'existe plus, et une tour d'escalier circulaire, restaurée au XIXe siècle.
1-1) La Bayle
a) Le pigeonnier
b) Les communs
1-2) La Haute Cour
a) L'enceinte
b) La tour porte
c) Les communs
d) Les logis XVs
1-3) La défense avancée
a) La tour 01
b) La tour 02
2.ORPHIN
2-1) Le site
Le nom Orphin viendrait du germanique Ulfin, dans lequel ULF signifie Loup. L’orthographe n’en a pas toujours été le même. Les prêtres écrivent « Orphin » dans les actes de l’état civil du XVII siècle ; ceux du siècle suivant orthographiant « Orfin » ; pendant la révolution on trouve indifféremment « Orfin » ou « Orphin » ; il en est de même pendant tout le premier quart de ce siècle, où l’on voit parfois les deux manières employées dans le même actes. Ce n’est que vers 1830 que l’orthographe « Orphin » a prévalue sur l’autre forme.
Il n’existe non plus aucun vestige de la féodalité, bien que le château de Haut Orphin passe pour les restes d’un ancien manoir féodal. Cette construction aujourd’hui transformée en exploitation agricole ou en maison de plaisance, se trouve sur le plateau qui domine la vallée, au milieu des bois qui l’entoure de tous les côtés sauf une clairière qui permet à ses habitants de surveiller l’ancien chemin de Rambouillet, dont il est éloigné de deux à trois cent mètres. Le fossé large de deux à trois mètres continuellement rempli d’eau, et quelques tourelles, hautes de trois mètres environ, percées de meurtrières, et placées dans le mur d’enceinte paraissent avoir donné lieu à cette tradition. L’importance de ce château s’il en fut un, n’a dû être que très secondaire et les constructions de l’époque ont complètement disparue depuis longtemps. Sainte Monégonde serait née à Orphin au VIe siècle, d'après Grégoire de Tours. L'identité des premiers seigneurs d'Orphin demeure inconnue. Les registres de l’état civil ne font nulle mention d’actes, baptêmes, mariages ou décès, se rapportant à des habitants de Haut Orphin, d’où l’on pourrait conclure que la château a été longtemps inhabité ou n’aurait été bâti qu’en des temps plus rapprochés.
Tout porte à croire au contraire qu’Orphin faisait partie du domaine des turbulents seigneurs de Gallardon dont il est éloigné de huit à neuf kilomètres. D’ailleurs, le bois placé entre Haute Maison et Cerqueuse porte encore le nom du bois de Gallardon. Probablement qu’après que le roi Robert 1er eut rasé le château de ce seigneur pour le punir de ses crimes, ce que le brave Dunois eut plus tard , réduit l’épaule à l’état où on la voit actuellement pour en déloger les anglais qui s’y étaient réfugiés (guerre de cent ans) les seigneurs de Gallardon perdirent beaucoup de leur importance ; les domaines éloignés en furent détachés et cette dislocation donna naissance à plusieurs autres manoirs, car les actes de l’état civil du XVIIe siècle par le des seigneurs de Poyers et de Cerqueuse, même d’un Sieur De Poncé, président du parlement, seigneur des Faures, comte d’Ablis, demeurant à Orphin et témoin relatant le baptême d’une cloche dont il était le parrain. La famille d'Orléans possédait la seigneurie d'Orphin avant la Révolution.
2-2) Le manoir du Haut Orphin
Des fossés et un mur d'enceinte entouraient ce château, probablement construit au XVe siècle, flanqué de tourelles percées de meurtrières. D'après une gravure de 1899, l'édifice était en ruine au XIXe siècle. Les bâtiments d'exploitation, ajoutés au XIXe siècle, ont disparu. Restauré au XXe siècle, le château conserve sa tour d'escalier.
a) Le pigeonnier
b) La tour et l'enceinte
c) Les logis
d) La tour d'escalier
2-3) Le prieuré
Une maison isolée, les nonnes, aujourd’hui transformée en habitation rurale et éloignée de près de deux kilomètres de toute autre habitation dans une dépression du sol qui en cache les bâtiments, parait d’origine très ancienne et nous rappelle, un ancien couvent de femmes.
- Une Tour au hameau de POYERS
3.SAINT LEGER EN YVELINES
3-1) Le site
La commune de Saint-Léger-en-Yvelines se trouve dans le centre des Yvelines, au cœur du massif forestier de Rambouillet, à 11 kilomètres au nord-ouest de Rambouillet, chef-lieu d'arrondissement et à 37 kilomètres au sud-ouest de Versailles, la préfecture du département.Le nom de Saint-Léger-en-Yvelines serait, selon certains historiens, lié au martyr de saint Léger, évêque d'Autun, assassiné en 678, qui aurait été noyé dans un étang de la forêt d'Yveline par son ennemi, Ébroïn, maire du palais de Neustrie et de Bourgogne.
Anciennement Sanctus Leodigarius, le château fort est une résidence royale de 987 à 1203. Cité importante au Moyen Âge, elle dépasse même Montfort-l'Amaury. Rambouillet à cette époque n'existe pas encore. Au cœur de la forêt d'Yveline qui appartient jusqu'au VIIIe siècle aux Mérovingiens (possession du roi Pépin le Bref en 768), puis aux Carolingiens, Saint-Léger, alors appelé Saint-Jean Baptiste, est récupéré pour le compte de la couronne par Hugues Capet en 987. Son fils au XIe siècle, Robert le Pieux y fera par la suite construire un château pour domaine de chasse. La citerne de la Muette, encore visible aujourd'hui, date aussi de cette époque. Fabriquée de pierre et de briques, elle alimentait le château en eau. Robert le Pieux fait également construire l'église en 1026, alors située dans l'enceinte du château pour une meilleure protection des attaques anglo-normandes. Cette défense est assurée par les places fortes de Montfort l'Amaury, d'Epernon, de Houdan élevées en partie sur l'initiative de Guillaume de Hainaut, à l'origine de la puissante maison des Montfort. En 1132, Louis VI fit une charte datée de Saint Léger, y contracta la maladie dont il mouru en 1137. Au XIIe siècle, le domaine est la propriété de Philippe-Auguste et le premier château digne de ce nom date de cette époque. En 1203, elle fut cédée à Amicie de Beaumont, comtesse de Montfort par Philippe Auguste. En 1206, Robert de Montfort fit construire l'église de Saint Léger dans la forêt d'Yveline. Après ce fut la croisade des Albigeois, et la mort de Simon IV de Montfort. Au début du XIIIe siècle, le territoire est récupéré par la comtesse Béatrice de Montfort. Elle y fait bâtir une aumônerie de 1 200 lits. Sa fille ainée, Yolande, récupère la partie du territoire du conté de Montfort où se situe Saint-Léger. La grande peste noir de 1348-1350 fit souvrir la région. En 1358, des bandes de pillard dévastèrent la région d'Yveline et Duguesclin les extermina en 1365. Les murailles du château furent relevés et on construisit le château fort de Rambouillet. En 1415, à la bataille d'Azincourt, Guillaume de Prunelé seigneur de Gazeran est tué (inhumé à la Celle les Bordes). A Grosrouvre, on se souvient encore du "camp des Anglais". Un écuyer, Jean Stanlawe, à la tête de 30 lances et de 90 archers à cheval, reçut l'ordre de démolir les places et forteresses de Saint Celerin, de Montfort, de Houdan, de Gambais, de Rambouillet et de Beyne. Le 13 juin 1434, la démolition des forteresses de l'Yveline semble un fait accompli.
En 1499, à la suite du mariage d'Anne de Bretagne et de Louis XII, le château de Saint-Léger réintègre le domaine royal et leur fille Claude, par son mariage à François Ier, la réunit au domaine royal en 1514. Il est ensuite confié par François Ier à André de Foix, qui commande la construction du haras afin d'y développer l'élevage des chevaux. En 1548, Henri II demande à Philibert de l'Orme de construire un nouveau château, dont il ne subsiste que quelques pierres, sur les vestiges du château médiéval. À cette époque, l'élevage de chevaux est pratiqué depuis des siècles dans la région et les Haras Royaux naissent au château. En 1667, à la demande de Louis XIV, le château est rasé et reconstruit plus loin, sur les bords de la Vegre. Louis XVI accorde au duc de Chevreuse, en 1692, la seigneurie pleine, entière et héréditaire sur le domaine de Saint-Léger et y resteront jusqu'en 1715. Puis, en 1706, la seigneurie est vendue au comte de Toulouse, qui l'intègre au marquisat de Rambouillet. Saint-Léger appartient ensuite successivement au duc de Penthièvre, à Louis XVI, qui l'achète en 1783, et à Napoléon à partir de 1805.
Les armes de Saint-Léger-en-Yvelines se blasonnent ainsi : De gueules au chêne d'argent, au chef cousu de France moderne.
3-1) La Bayle
Le château fort, de dimension considérable, dans l'enceinte duquel était située l'église.Il faut distinguer ce château , de la maison que les seigneurs de Montfort tenaient du roi, probablement à cause de leur charge héréditaire de "Gruyer de l'Yveline".
a) L'enceinte basse XIIs
b) L'église XIIIs
3-2) La Haute Cour
a) L'enceinte
b) La motte castrale
c) La tour
d) Le bastion XVIs
e) Les communs XVIs
3-3) Le Château du Haras
Ce château-haras royal est édifié vers 1535 pour André de Foix, puis racheté en 1668 par Louis XIV. Celui-ci fait réaliser des travaux de restauration et d'agrandissement par Jean Fieve. Le domaine s'étend peu à peu : des fermes et des maisons consacrées à l'élevage des chevaux lui sont adjointes, de nouvelles terres sont achetées en 1672. En 1715, le haras est transféré en Normandie. Dans le relevé cadastral de 1830 seul subsiste le château, qui est détruit à la fin du XIXe siècle. Le portail, qui donne sur la route de Houdan, est le seul témoin du haras construit en 1540. La suppression de l'arc et le rehaussement de la chaussée ont modifié son aspect originel. Son ornement de brique et de pierre en damier est extrêmement rare dans le sud du département.
3-4) La Maison Forte des Montfort
4.RAMBOUILLET
4-1) Le site
Rambouillet est mentionné en 768 dans le document qui consigne la donation de la forêt d'Yveline par Pépin le Bref à l'abbaye de Saint-Denis. Au cours de la guerre de Cent Ans le château est pris et incendié. Le château est successivement propriété de la famille d'Angennes, de Fleuriau d'Armenonville, puis du comte de Toulouse et de son fils le duc de Penthièvre. Rambouillet devient ville royale grâce à Louis XVI, qui acquiert le domaine en 1783 et nomme le comte d'Angiviller gouverneur de la ville. Dès 1804, Napoléon décide de faire rénover le château. En 1811, Rambouillet devient sous-préfecture de Seine-et-Oise. Le premier château, fortifié, est construit vers 1370 pour Jean Bernier, conseiller de Charles V. Regnault d'Angennes, premier écuyer et Chambellan de Charles VI, acquiert le domaine en 1384. Après la guerre de Cent Ans, le château est restauré et agrémenté d'un parc. Selon la légende, François Ier y meurt en 1547. À l'époque de Jaques d'Angennes, en 1556, l'architecte Olivier Imbert réalise des aménagements d'inspiration italienne, notamment l'escalier et la salle de marbre du rez-de-chaussée. Fleuriau d'Armenonville devient propriétaire du château en 1699 et se consacre à l'embellissement du parc. Il fait notamment creuser des canaux et des bassins dans lesquels il fait aménager des iles. En 1704, le comte de Toulouse, dernier fils légitimé de Louis XIV et de Mme de Montespan, prend possession du domaine, où il accueille la cour. De nombreux travaux sont commandés à l'architecte Jacques Sarda. Le nombre des appartements est doublé grâce à l'ajout aux ailes anciennes de deux nouveaux corps de logis. Les deux ailes sont réunies par un mur d'appui en hémicycle surmonté d'une grille. Les fossés sont comblés, les ponts-levis supprimés et de nouveaux canaux creusés. Le duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse, vend Rambouillet à Louis XVI, qui complète les aménagements du parc et de la ville mais ne remanie pas le château. Une collection alors unique d'arbres exotiques est plantée : érable de Tartarie, vernis du Japon, pin de Virginie ou cyprès chauve de Louisiane. En 1804, séduit par le domaine malgré l'état d'abandon dans lequel il se trouve depuis 1793, Napoléon Ier charge l'architecte Auguste Farmin d'aménager le château en rendez-vous de chasse et maison d'habitation. La remise en état est achevée en 1807 et les canaux et étangs sont curés. En 1810, Farmin fait installer une salle à manger, une chambre supplémentaire, crée une salle de bain de style pompéien, classée en 1944, et aménage un long balcon extérieur réunissant les appartements de l'empereur à ceux de l'impératrice. En 1896, sous Félix Faure, le domaine devient officiellement résidence présidentielle.
Les armes de Rambouillet se blasonnent ainsi :
Parti à senestre de sable au demi sautoir d'argent, qui est d'Angennes, mouvant de partition, à dextre tiercé en fasce, en un d'or au cerf contourné au naturel, en deux de gueules au bélier d'argent et en trois d'argent au chêne en sinople ; en abime : d'azur à trois lys d'or brisé d'un bâton péri de gueules, qui est de Bourbon, comte de Toulouse.
Le blason de Rambouillet évoque l'histoire et différents aspects caractéristiques de la ville.
La partie senestre (à gauche sur l'image) représente les armes (de sable au sautoir d'argent) des anciens seigneurs de Rambouillet, la famille d'Angennes, qui conserva le château pendant près de trois siècles.
La partie dextre (à droite sur l'image) évoque divers aspects de la ville, encore actuels :
- le cerf représente le gibier de la forêt de Rambouillet, longtemps domaine de chasse royal puis national,
- le bélier fait référence au troupeau de mérinos de Rambouillet importé d'Espagne par Louis XVI,
- le chêne symbolise la forêt de Rambouillet elle-même.
L'écusson central est le blason de Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, fils naturel légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, qui acheta en 1706 le domaine et le château de Rambouillet où il est mort en 1737 (ce sont les armes de France chargées du bâton péri de gueules, symbole de bâtardise).
Ces armoiries auraient été créées par le secrétaire de mairie en 1887.
4-2) Le château
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Le bas Prunay et sa tour sarrasine
Le BAS-PRUNAY
Tour Forte du XIs aux origines incertaines
BULLION - La CELLE les BORDES- SONCHAMP
La région entre Montfort et Rochefort tome IV
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La commune de Prunay-en-Yvelines se situe à environ 15 km au sud de Rambouillet et 49 km au sud-ouest de Versailles. Le territoire est très étendu et regroupe la paroisse de Craches, Labbe, Marchais-par-Fond, Gourville, La Chapelle, Villiers-Landoue, la ferme de Presles et la paroisse de Prunay.
L'origine du Prunay de son nom vient du latin prunetum, "pays des prunes". Mentionné depuis le 11è siècle, Le nom de Prunay, sous la forme de Prunetum apparaît en 1162, mais le village existait depuis longtemps, puisqu'une église à une seule nef était déjà présente.
En 1148 Galeran II, époux de Agnès de Montfort, part pour la croisade avec le roi de France Louis VII. Agnès fait le vœux de construire 17 églises sur les comtés de Montfort et de Meulan si son époux revient de Terre sainte. Au retour de son époux, elle tient parole. Un important clocher octogonal, à base carrée vient compléter l'église. Il est contemporain du clocher sud de la cathédrale de Chartres. Prunay est cité en 1255 dans un cartulaire de la léproserie du grand Beaulieu signalant l'abandon des biens détenus par Gérard de Prunay au profit de la maladrerie. Jean Balu est seigneur de Prunay en 1415. Au XVIe siècle, la seigneurie appartient à la famille Poncet de La Rivière. En 1546, les moines célestins d'Esclimont construisent un couvent, et une maison forte est édifiée en 1554, au milieu du domaine monacal de Gourville, pour protéger ses habitants des Normands et assaillants du Sud. Le château des Faures, édifié sur le domaine des Poncet de La Rivière et ancienne résidence des comtes d'Ablis, devient la propriété de la famille La Rochefoucauld au XIXe siècle. Il est partiellement démoli en 1843.
Les armes des Montfort se blasonnent ainsi : D'azur au lion à la queue fourchée d'argent
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.Le PRUNAY en Yvelines
1-1) Le site
La tour du bas Prunay fait partie d'un système de défense édifié vers 1060 et marque la limite entre les terres de Gourville, dépendant des moines de Chartres et celles de Prunay, vassales des seigneurs de Montfort. La dénomination de « Tour sarrazine » n'est justifiée que par sa forme carrée à la base.
1-2) Le château fort du Bas-Prunay
Les vestiges d'une tour forte en moellons sont probablement à ceux d'une fortification du XIe siècle. De nombreuses hypothèses sont émises quant à la nature et la date de construction de cette tour carrée aux angles arrondis. En effet, il est étonnant de trouver une tour de guet défensive dans un creux et non sur une hauteur. Cela laisse supposer qu'elle n'a peut-être pas été construite à des fins militaires. Les restes d'enceinte, de logis, d'une porterie et d'une tour sont également les signes d'un château fort élevé par les Montfort comme limite de frontière. En comparaison on peux le mettre dans la même catégorie que Houdan (Vigie contre la Normandie) comme une caserne vigie contre la beauce (Epernon, le Puiset etc...).
a) L'enceinte
L'enceinte comme la tour pourraient daté d'une reconstruction au XIIIs.
b) L'arc de décharge
Arc de passage d'un ancien rû ou renforcement de la maçonnerie ??
c) La porterie XVs
Cette porterie du XVs ressemble beaucoup à celle de la maison forte de Gourville. Elle est composé (en belles pierres de taille) d'une porte piétonne et d'une porte charretière.
d) La tour d'enceinte
Cette tour pourrait faire partie de part sa position à un ancien châtelet d'entrée du XIIIs, composé initialement de 2 tours circulaires.
e) La tour maîtresse XIs dite "Sarrasine"
Cette tour de forme carrée à des angles arrondis par soucis d'économie et ainsi éviter l'emploi de contreforts circulaires dont les rôles sont similaires. Ces murs sont du XIs (construction des comtes de Montfort), mais a été refaite au XVs, les fenêtres ou fentes de jour ont été remplacé par des meneaux simples.
f) Les logis
1-3) Le Manoir du Haut-Prunay??
L'église de Prunay Saint Pierre et Saint Paul (XII-XVs) est un édifice roman à nef unique, terminé par un chevet plat. Le clocher octogonal est édifié par Agui de Montfort. Il est contemporain du clocher sud de la cathédrale de Chartres. La guerre de Cent Ans épargne l'édifice, malgré la présence dans les environs des « Grandes Compagnies ». Le clocher à flèche de pierre, rare dans le sud des Yvelines, abrite une des cloches les plus anciennes du département. Elle est dédiée à saint Pierre et a été fondue en 1584. Proche de cette église existe un vaste mur à contreforts plats, conservé sur 2 côtés, vestiges d'une maison forte ou d'enceinte urbaine ??
2.BULLION
2-1) Le site
Tout au long de son histoire, la commune se trouve dénommée, selon les divers écrits, Bualo (615), Budalo (1085), Boolon, Boelon au XIIe siècle, Boeleium au XIIIe siècle, Boullon ou Boulon au XVe siècle (peut-être ne s'agit-il, pour certaines dénominations, que de simples coquilles de copistes). Le village est arrosé par la petite rivière dite de la Celle prenant sa source au-dessus de la Celle-les-Bordes et descendant par Bandeville, Saint-Cyr-sous-Dourdan, pour aller se jeter dans la Remarde, et pour le hameau de Moutiers par la petite rivière de Sainte-Anne, prenant ses sources dans les bois de Moutiers et dans la fontaine de Sainte-Anne à Moutiers". C'est ainsi que l'abbé Vitry, curé de Bullion, présente le village dans une note adressée en 1869 à la Société Archéologique de Rambouillet.
L'une des premières mentions de Bullion, apparait dans un testament de Bertrand, évêque du Mans, daté de 615. Sans doute, le hameau passa-t-il, comme la plupart des villages alentour, dans le domaine royal. Son histoire sera alors liée à celle de la région environnante et du pays d'Étampes qui, au début du Xe siècle, furent ravagés et totalement dévastés par Rollon et ses normands. En 911, le traité de Saint Clair sur Epte mettait fin à leur pillage et"les asiles"(donjons et châteaux) désormais inutiles servirent aux seigneurs contre le roi et le peuple; c'est le début de la féodalité rendue encore plus puissante par l'hérédité des fiefs. C'est ainsi que se constituèrent les seigneuries de Montfort puis de Rochefort en Yvelines. Dès le début du XIe siècle en effet, les Yvelines entraient en composition de trois domaines: celui des seigneurs de Montfort, celui du seigneur ou comte de Rochefort qui avait le sud-est de la forêt avec Rochefort et Saint Arnoult et beaucoup d'autres endroits situés en dehors des Yvelines à l'est et au nord de Rochefort, et enfin le domaine royal d'Yveline ou prévôté de Saint Léger. Le cartulaire de Saint Rémy des Landes, paroisse de Clairefontaine, dit ceci relativement au nom de Bullion:"Monseigneur de Bullion connu de tout le monde à cause de sa surintendance dans les finances de sa majesté, ne fut pas à peine seigneur de la Paroisse de Boullon qu'il en changea le nom et lui fit porter le sien et présent s'y est-il que personne ne l'appelle plus autrement". Bullion ne doit en effet son nom qu'à Claude de Bullion, originaire de Mâcon, qui, en 1611,se rendait acquéreur de la seigneurie de Boullon. Le 5 mars 1482, Jean de la Motte, écuyer, se trouve en possession de la terre et seigneurie de Boullon. Il avait pour femme Mathurine Lecomte. Le 6 septembre 1489, Jean de la Motte fit l'acquisition du fief, terre et seigneurie de Guédonne, paroisse de Bullion, de Jean Belin, tailleur en robes, demeurant à Paris, puis, le 22 décembre 1494, du fief terre et seigneurie de Longchêne, d'Antoine Davelluys, seigneur de Beauvilliers et de Longchêne, chambellan du Roy. Le 17 janvier 1495, il prend le titre de seigneur des Carnaux et de Boullon et meurt en 1509. La famille de La Motte, propriétaire du domaine de Boulon, s'allie à celles du Vandosmois et de Bueil. En 1600, la seigneurie revient au poète académicien Honorat de Bueil, disciple de Malherbe. Les arrières-arrières petites filles de Jean de la Motte, Marguerite et Sydoyne de Vendômois, devaient, par contrat passé devant Bideault, Notaire à Paris, vendre à Claude de Bullion, conseiller du roy, (garde des Sceaux, seigneur de Bonnelles et de Gallardon) la seigneurie de Boullon. Le 26 juin 1611,celui-ci acquiert donc le château, les terres et seigneuries de Boullon et des Carneaux avec haute et basse justice et devient Seigneur de Bullion, car c'est ainsi, selon la décision du nouvel acquéreur, que se nommera son nouveau domaine.La seigneurie devait appartenir à ses descendants jusqu'à la Révolution. Les titulaires en furent les Ducs d'Uzès à partir du mariage de Jean-Charles Emmanuel de Crussol d'Uzès, le 13 mars 1706, avec Anne-Marie-Marguerite de Bullion, arrière petite fille du conseillier du Roy. Les terres entrent dans le patrimoine des ducs d'Uzès, qui les conservent jusqu'en 1935. Au XIXe siècle, le manoir des Carnaux est transformé en ferme, celui de Ronqueux devient la propriété du général Digeon, puis d'Hendecourt en 1867, qui fait don d'un terrain pour la construction de la mairie et de l'école. Les autres propriétés à Bullion sont celles de la famille Bourbon-Baudoin, le domaine du Gué, et le rendez-vous de chasse de Moutiers, pied-à-terre du marquis de Crussol d'Uzès jusque dans le courant du XXe siècle. La famille Lehideux possèdait le château de Ronqueux et un manoir à Longchêne.
Les armes de Bullion se blasonnent ainsi :
D'azur aux trois fasces ondées abaissées d'argent, au lion d'or issant de la première fasce.
2-2) Le manoir seigneurial des "Carnaux"
Le manoir fut habité par la famille de la Motte à partir de 1495. Il est probable que le manoir ait été construit bien avant eux. Les archives nationales parlent de : place forte formant à l’origine un quadrilatère presque régulier, flanqué de tours aux angles et entouré de murailles très épaisses protégées par des fossés d’environ 10 mètres de largeur. Le mot Carnaux signifie créneaux en vieux français, ce qui laisse penser que le nom du hameau viendrait de l’ancien manoir qui avait des aspects de place forte. Le manoir fut, entre autres, la résidence des seigneurs de Bullion et de la famille Crussol d’Uzès. Ancienne résidence des seigneurs de Bullion pendant plusieurs siècles, ces bâtiments sont transformés en ferme au début du XIXe siècle. Les bâtiments ont été restaurés au début des années 1990 par le propriétaire actuel. Ce vaste manoir des XIV-XVs est construit en grès et en meulière (pierre fragile et peu utilisé pour ce type de construction). Un grand et haut logis, flanqué d'une tour d'escalier et de 2 tourelles, domine une vaste cour encadrée par les étables et les granges. Un colombier, imposant et trapu, a été placé un peu en retrait, sans doute afin d'éviter aux propriétaires les désagréments causés par le bruit des volatiles. Des traces d'une vaste d'enceinte initialement munie de tours cerne le manoir.
2-3) Le Prieuré Sainte Anne XI-XIIs
Cette chapelle constitue le vestige d'un prieuré bénédictin qui dépendait de Saint-Maur-des-Fossés. Elle aurait été dédiée à sainte Scariberge jusqu'au XVIIIe siècle. L'édifice, restauré récemment, garde des éléments anciens, tels des parties d'appareil en arêtes de poisson et des petits contreforts plats.
2-4) Le château de Ronqueux
Le château de Ronqueux est en cours de restauration. L’édifice actuel avait été bâti en 1910, à l’emplacement d’un ancien château attesté à la fin du XVIIIe siècle.
3.La CELLE LES BORDES, le château des "Bordes"
3-1) Le site
Appelé autrefois La Celle-en-Yveline (Cella Aequilina) ou La Celle-Saint-Germain ou La Celle-près-Cernay (XIIIs) et parfois La Selle, le village tient son nom du latin Cella qui désigne un oratoire ou monastère fondé au VIs à la demande de Saint Germain, évêque de Paris, par le roi Childebert Ier. Autour du petit couvent se forme une agglomération rurale qui s'appelle d'abord La Celle-Saint-Germain, puis La Celle-en-Yvelines, puis La Celle-les-Bordes. L'une des premières mentions de la localité figure dans une charte de Charlemagne de 774. Dans les années 800, un manoir, deux moulins et deux églises relèvent de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Du XI au XIIs, le village passe au second plan suite aux rivalités entre les seigneurs de Montfort et de Rochefort. Le premier sanctuaire, reconstruit en 1524, est dédié à saint Germain, et un second est dédié à saint Jean au XIVe siècle. Pierre de Harville achète le fief de La Celle en 1363, sous le règne de Jean le Bon, alors que rien ne subsiste du monastère fondé par Saint Germain, sa famille en restera propriétaire jusqu'au milieu du XVIIs (pendant plus de trois siècles). Le plus connu de la lignée est Claude de Harville qui à fait un riche mariage avec Catherine des Ursins et qui a joué le bon cheval sous Henry IV durant la guerre civile. Comblé des faveurs royales, Claude de Harville (†1636), marquis de Palaiseau, fait construire l'actuel château de La Celle vers 1580, qui en 1713, devient la propriété des Bourbons-Penthièvre, puis des Verneuil. Vers 1816, le marquis d'Alvigny, en épousant une demoiselle Verneuil, devient le nouveau châtelain. Son fils vend le domaine à Cibiel, membre de la Chambre de députés. En 1843, la duchesse d'Uzès y installe les trophées de chasse de l'équipage du Rallye Bonnelles. Quant au château des Bordes, il appartient à la famille Dumon-Marchal, qui crée dans le domaine un parc à sangliers.
Au hameau de La Celle, face à l'église, se dresse le château de la Celle que la duchesse d'Uzès utilisait comme rendez-vous de chasse. Pierre Duplessis le décrit comme « un manoir d'Henri IV lambrissé de bois de cerfs ; les murs, les poutres et les salines y disparaissent dans l'enchevêtrement magique. Une nuit, invités par la duchesse, nous y vinmes lire, aux flambeaux, la légende de saint Julien l'Hospitalier ». En 1902, la Saint-Hubert est fêtée dans la cour. Le duc de Brissac, petit-fils de la duchesse, se souvient « d'un orme sur la pelouse entre le château et l'église âgé de 290 ans » ; l'arbre a été depuis abattu.
Le château des Bordes est un ancien château fortifié dont il ne reste que les deux tours et l'entrée ainsi qu'un corps de bâtiment annexe.L'entrée du château, constituée d'un châtelet encadré par deux tours circulaires, témoigne d'une construction médiévale. À proximité, une grange et un colombier circulaire proviennent d'aménagements ultérieurs. Le domaine, qui s'étend jusqu'au hameau de La Celle-les-Bordes, est clos par un mur. Au XIXe siècle, un nouveau château, agrémenté d'un parc à l'anglaise, y est construit. On sait peu de chose du château des Bordes. On peut penser que c'est l'insécurité qui est à l'origine de la construction d'un lieu fortifié sur le rebord de plateau, facile à défendre et surveillant la plaine vers le nord. Il n'en subsiste rien hormis des éléments annexes: un corps de logis et la belle entrée cantonnée de 2 tours rondes qui se mirait naguère dans une mare. On sait qu' Alexandre des Bordes, parent de Guy de Levis, favorisa la fondation de l'abbaye Notre Dame de la Roche, et que Philippe des Bordes vivait au XIVs (sa femme est ensevelie dans l'église de la paroisse de La Celle).
4.SONCHAMP
4-1) Le site
Le site de Sonchamp est occupé dès l'époque néolithique, comme en témoignent un gisement tardenoisien, industrie caractérisée par des petits outils de silex taillés géométriquement, dans le bois de Plaisance et des monnaies trouvées près de la Remarde, entre Sonchamp et le hameau de Pinceloup. Le nom de Sonchamp apparait en 1160 dans l'acte de fondation de l'abbaye de Saint-Rémy-des-Landes. Le cartulaire de l'abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire, dont dépend la seigneurie foncière de Sonchamp, signale en 1190 que Philippe Auguste abandonne les 3 setiers d'avoine qu'il percevait à Sonchamp sur un terrain acquis pour établir le cimetière. En 1201, la charte de Simon III de Montfort fait état des bois de Saint-Benoit, à proximité du bourg de Sonchamp. Les guerres de Religion n'épargnent pas la localité. Le 15 septembre 1701, le domaine cesse d'être la propriété de l'abbaye de Saint-Benoit et passe à Fleuriau d'Armenonville, marquis de Rambouillet. Sonchamp est l'une des communes les plus étendues du département. Elle intègre les anciens fiefs de Chattonville, Épainville, Chênes-Secs, Les Bordes, et Greffiers, dont la chapelle dépendait de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, les hameaux et écarts, sur lesquels de nombreux manoirs sont érigés, en sont issus. De nombreuses fermes témoignent de l'activité agricole.
Les armes de Sonchamp se blasonnent ainsi : Tranché de vair et d'argent, à une bande de sinople semée de mouchetures d'hermine d'or brochant sur la partition.
4-2) Le manoir d'Epainville
Cette demeure du XVIIs est construite à l'emplacement du manoir seigneurial détruit dans un incendie en 1599. Les quelques maisons groupées autour de celle-ci constituent le hameau d'Epainville, au milieu des champs.
4-2) Le manoir de la Tourelle
Cette maison édifiée du XIe au XVIe siècle, serait la plus grande de Sonchamp, elle se distingue par sa tour hexagonale hors oeuvre. Cette dernière abrite un escalier à vis.
4-4) Hameau: Butte des bordes
Ce jolie hameau devenu un lieu de résidense, à un nom évocateur et se situe à 500m au Sud de Sonchamp. A ma connaisance aucune histoire connue et pourtant à l'entrée du hameau, on trouve un tertre de forme ovale, en partie détruit par des champs agricoles. On discerne des vestiges de fossés (route actuelle) et à son sommet beaucoup de pierres de parement de bonne taille. Peut on y voir les restes d'un château fort ancien (XIs) ou un oppidum antique?, le mystère reste entier. Lors de ma visite, j'y ai trouvé des morceaux de Tégula à rebord (tuile plate Romaine) et des fragments de poterie noir grossière (de la Tène?).
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Gourville et les Montfort, Tome III
GOURVILLE
Maison Forte XVs aux origines incertaines
ORSONVILLE - Les BORDES- Sainte MESME
La région entre Montfort et Rochefort tome III
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
Commune au Sud du Prunay en Yvelines dont elle dépend. L'origine du Prunay de son nom vient du latin prunetum, "pays des prunes". Mentionné depuis le 11è siècle, Prunay est cité en 1255 dans un cartulaire de la léproserie du grand Beaulieu signalant l'abandon des biens détenus par Gérard de Prunay au profit de la maladrerie. Jean Balu est seigneur de Prunay en 1415.
La terre de Gohervilla, devenue Gourville, aurait été donnée aux bénédictins de Saint-Père-de-Chartres par la comtesse Chartraine Letgarde au Xe siècle. Vers 1200, les bénédictins y édifient le prieuré Saint-Laurent, dont seul le nom du lieu-dit Le Muid-Saint-Laurent conserve le souvenir, Les moines firent prospérer la vigne au long des coteaux, au lieu dit de « La vigne aux Moines ».. La maison forte, probablement construite pour l'abbé du monastère, François de Brilhac vers 1425, est devenue la propriété des évêques de Chartres. La guerre de Cent ans épargne l'édifice, malgré la présence à Gallardon des « Grandes Compagnies ». La vaste enceinte trapézoïdale comprend un corps de logis central formant logis-donjon et une tour ronde au nord-est rajoutée au XVIs. Les culs-de-lampe aux angles constituent les seuls vestiges des échauguettes. Cette enceinte est renforcé de tours circulaires aux angles et de saillants carrés. En 1546, les moines célestins d'Esclimont construisent un couvent, et la maison forte est reconstruite en 1554, au milieu du domaine monacal de Gourville, pour protéger ses habitants des Normands et assaillants du Sud. Le château des Faures, édifié sur le domaine des Poncet de la Rivière et ancienne résidence des comtes d'Ablis, devient la propriété des La Rochefoucauld au 19è siècle. Il est partiellement démoli en 1843.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.GOURVILLE, la maison Forte
1-1) Le site
Maison forte de Gourville XV - XVIs: vaste enceinte trapézoïdale où s'inscrit un corps de logis central formant donjon auquel sont accolées au nord une tourelle carrée et au nord-est une grosse tour semi circulaire du XVIs, coiffée d'un toit en poivrière surmonté d'un clocheton. A l'intérieur, hors l'escalier à vis on trouve au R.d.C. la salle des gardes avec sa magnifique cheminée XVs, sa cuisine et à l'étage la grande salle avec une cheminée XVs.
1-2) La bayle
a) Les logis
b) La tour forte
c) L'enceinte
d) La porterie
e) La tour ronde A
f) La tour ronde B
g) La tour carrée saillante C
h) Les fossés
1-3) La haute cour
a) Le pont dormant
b) Les logis
c) La tour maîtresse XVIs
d) La tour porte
e) La chapelle castrale
2.ORSONVILLE
2-1) Le site du manoir seigneurial
Étymologie : le nom d'« Orsonville », vient probablement du latin Ursionis villa, le domaine d'Ursius, du nom du premier prieur de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs à Paris. Au Moyen Age, Orsonville dépend probablement du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, fondé à Paris en 1059 par Henri Ier. La ferme fortifiée de Gauvilliers est celle d'un fief du XVe siècle. Une école est implantée en 1701. La famille de Colbert-Chabanais, issue du ministre de Louis XIV, possède presque toutes les terres jusqu'en 1848. Du château construit en 1805, seuls subsistent les communs.
a) Les communs
b) L'enceinte
c) Les logis XIIIs
Manoir construit vraisemblablement au cours des XIII-XIVs; ensemble remanié pendant le 4e quart du 19e siècle, sauf le porche d'entrée et le logis. Porte d'accès au logis au premier niveau.
d) La chapelle castrale XVIs
Au pied de l'église Saint Denis du XIIs, chapelle castrale début XVIs, style de la première renaissance. Nef aussi large que longue, dont la construction n'a pas été fini.
e) Le moulin
La Beauce est par excellence le pays du blé, et les moulins à vent étaient nombreux dans la région. Ils ont pratiquement disparu du paysage. Moulin datant du XVIIs, transformé en habitation mais dont la fonction et la datation réelle reste un mystère. La porte d'accès au r.d.c possède un logement pour: une herse ou un vanteau??, à l'intérieur on trouve des consoles pour la fixation de plancher (1ier et 2ième niveaux), et des fenêtres anciennes, l'épaisseur des murs étant d'environ 1,50m.
f) La maison forte XV-XVIIs
Maison forte en face du manoir seigneurial, possèdant une forte tour en fer de cheval.
2-2) La ferme fortifiée de "Les Borde"
Cette ferme dépendant de Sonchamp est celle du plus grand domaine du canton au XVe siècle. Ce domaine comprend alors le château du Mesnil, Le Bréau et Le Goulet, sis sur le territoire de Saint-Arnoult, ainsi que les terres de Ponthévrard. En 1499, la dame des Bordes, Jehanne de Manterne, épouse Jean du Pontbriand, qui accède ainsi à la seigneurie du Mesnil. L'un de leurs descendants devient le premier gouverneur de Saint-Arnoult.
Les armes de Sonchamp se blasonnent ainsi : Tranché de vair et d'argent, à une bande de sinople semée de mouchetures d'hermine d'or brochant sur la partition.
a) Le mur d'enceinte
b) La porterie
3.SAINTE MESME
3-1) Le site
Vers la fin du Véme siècle, furieux d'apprendre que sa fille reniait les dieux païens, le comte de Dourdan (le roi Franc Rex Dordanus) demanda à son fils Mesmin de trancher la tête de sa soeur, la vierge Maxima. Juste à cet endroit jaillit une source miraculeuse. Il se convertit, fit pénitence et fonda l'abbaye de la chapelle Saint Mesmin près d'Orléans. Deux fontaines rappellent ce souvenir, la plus connue, située en plein bourg, porte un groupe naïf représentant le martyre de la Sainte.
Au Moyen Âge, la seigneurie de Sainte-Mesme relève du roi et dépend de Dourdan. La Seigneurie au 11ème dépend de Ligier d'Orgerii (ou Dorgesin). Le château fut construit fin 12ème par les seigneurs de la Chapelle, puis refortifié par les descendants de Ligier d'Orgerii. Au XVs, Aymard de Poisieu (grand ami de Louis XI), seigneur de Sainte-Mesme, fait reconstruire l'église et le château. La seigneurie de Sainte-Mesme est transmise à la famille de L'Hospital par le mariage de Louise de Poisieu conclu en 1510. Erigée en comté par Henri IV, le château est remanié au XVIs, puis au XVIIe siècles et il sert de prison pendant la Révolution. En 1804, Charles François Lebrun, troisième consul de la République et propriétaire du château de Sainte Mesme le transforme en une usine de fabrication de cotonnades qui ferme en 1895.
Le manoir est situé en face du château, dont il dépend appartient alors à la seigneurie de Sainte-Mesme, avant le Xe siècle. L'occupation du site est beaucoup plus ancienne. La restauration du manoir a en effet révélé l'existence de source fréquentée depuis le paléolithique. Les fondations semblent établies sur l'emplacement d'anciens thermes gallo-romain. La base ronde de la tour, dotée d'un contrefort périphérique et d'une cave signale vraisemblablement une construction carolingienne. Au XVe siècle, l'édifice est transformé. Il est équipé de fenêtres à meneaux et une tour octogonale est érigée. meneaux primitifs en grèsun , découverts lors de travaux d'assainissement, ont été réutilisés en bordures de pavés en 1880, après avoir été cassés pour permettre la pose de volets extérieurs. Le manoir est un modèle d'architecture civile, dont subsistent peu d'exemples en Île-de-France. A l'intérieur un escalier à vis (du XIIIs) relie le rez-de-chaussée au premier étage. Sur le noyau central, à la cinquième marche, il présente la particularité de comporter une pièce de grès taillée et façonnée pour être le départ de 2 marches. En outre, les 7 marches monolithes demeurées intactes répondent à un modèle de construction répandu à partir du XIIIe siècle. Depuis le premier étage, l'accès au grenier se fait également par un escalier à vis. La base du noyau en chêne de cet escalier est de diamètre égal au noyau en grès sur lequel elle repose. Les marches sont en silex, noyé dans un mortier de chaux éteinte, et les nez de marche sont en chêne.
L'entrée s'étend sur toute la largeur du manoir. Elle dessert une grande salle et, dans la partie modifiée en 1880, une cuisine équipée d'un potager ainsi qu'une salle à manger. Le mur sud est un mur de refend entièrement à colombage. C'est le seul mur d'origine qui subsiste à l'intérieur. Comme tous ceux du manoir, le plafond à la française est en chêne. Le carrelage d'origine a été découvert sous des dalles en pierre blanche mises en place au XIXe siècle. Le carrelage initial avait été posé sur un lit de sable, à même la terre battue, et joint à la chaux éteinte. La porte du fond donne accès à la tour, dans laquelle est ménagé l'escalier menant aux appartements du premier étage et au grenier.
Les armes de la famille poisieu-de-l'hospital se blasonnent ainsi :
Ce panneau, situé sur la chaire, représente le blason de la famille Poisieu de L'Hospital, qui a compté plusieurs lieutenants généraux. Aymard de Poisieu était l'un des capitaines de Louis XI. Son fils Claude de Poisieu lui succède et prend comme officier Adrien de L'Hospital. En 1510, les deux familles sont unies par le mariage d'Aloph Gallucio de l'Hospital avec Louise de Poisieu. Aloph meurt en 1561.
3-2) Le manoir seigneurial (1 rue Charles-Legaigneur)
3-3) Le château fort
Le premier seigneur de Sainte Mesme fut Ligier d'Orgeri (ou d'Orgesi) qui partit pour la première croisade prêchée par le Pape en 1095 et n'en revint pas. C'est Adam de la Chapelle et son fils Etienne qui entreprirent la construction du château de Sainte Mesme au XII ème siècle. Il ne reste que les douves et quelques pans de mur qui sont intégrés dans la construction actuelle. Les autres propriétaires du château furent la famille de l'Hôpital. Château du XIIs avec fortification du XVs, constitué d'un donjon rectangulaire flanqué de tourelles et de tours d'angle, le tous entouré de douves en eau.
Aubert de La Chapelle fonde la chapelle seigneuriale avant 1343, qui est l'année de sa mort. Cette pierre tombale, scellée au mur de la chapelle Sainte-Anne, représente les époux.
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Brethencourt, fief des Montfort
BRETHENCOURT
FORTERESSE de Guy de Rochefort dit "le Rouge"
SAINT ARNOULT - GAUVILLIERS - CLAIREFONTAINE
La région entre Montfort et Rochefort tome II
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La commune de Saint-Martin-de-Bréthencourt se trouve dans le sud des Yvelines, à la limite entre les régions naturelles de Beauce et du Hurepoix. Elle confine vers l'est avec le département de l'Essonne. La commune est irriguée par l'Orge qui y trouve sa source et par un affluent de rive gauche de celle-ci, le ruisseau des Bois (3,9 km) qui prend sa source au centre de la commune. L'Orge marque sur quelques kilomètres la limite avec la commune de Corbreuse.
Au Moyen âge, le village, dénommé Bréthencourt, prend pour patron saint Martin. Anciennement "Bretencourt", "Breteucourt", "Bertrand-Court", la seigneurie de Bréthencourt fut dépendante de la châtellenie des Rochefort. Au XIe siècle, Guy le Rouge fait bâtir un imposant château fort sur l'éperon qui commande la vallée de l'Orge à la frontière du domaine des Monthléry-Rochefort et des Montfort, en face de Dourdan, fief des Capétiens. Cette construction complète la ceinture fortifiée du sud de Paris qui va de Châteaufort à Puiset en passant par Montlhéry. Vers 1080, la salle du château accueille une grande assemblée d'évêques, de chevaliers et de religieux, invités à témoigner de la donation du comte Guy et de sa femme Adélaïde à l'abbaye de Marmoutiers-lès-Tours. Un prieuré bénédictin dépendant de cette abbaye est alors fondé. À la mort de Guy le Rouge en 1108, le domaine passe aux Garlande. En 1108 le prince Louis, futur Louis VI, assiège ce château sans succès. En 1120 Brethencourt passe avec Rochefort dans le patrimoine des Montfort dont il devint un des château. En 1181 Brethencourt fut dévolu avec Beynes à Guy de Montfort, frère de Simon IV, le futur chef de la croisade contre les Cathares.
Parenthèse sur un personnage: Guy de Montfort, tué à Varilhes le 31 janvier 1228, fut seigneur de la Ferté-Alais et de Bréthencourt, régent du comté de Sidon de 1205 à 1210 et seigneur de Castres de 1211 à 1228. Il était fils de Simon (IV), seigneur de Montfort et d'Amicie de Beaumont, comtesse de Leceister. En 1188, il prit part à la troisième croisade. Compte tenu du fait qu'il s'engagea également dans la suivante, il est concevable de penser qu'il resta en Terre Sainte quand le roi Philippe Auguste revint en France, et ne rentra qu'en 1992, en même temps que Richard Cœur-de-Lion. Frère cadet de Simon IV de Montfort, il s'engagea avec lui dans la quatrième croisade, en 1202. Arrivés à Zara, après avoir désapprouvé la prise de la ville, ils refusèrent le marché qu'Alexis Ange proposait aux Croisés, et qui consistait à payer le passage en Terre Sainte en échange de leur aide pour rétablir Isaac II Ange sur le trône. Il se rendirent par leurs propres moyens dans le royaume de Jérusalem, en embarquant à Barletta, dans les Pouilles. Arrivé à Jaffa, il rejoignent le roi Amaury II de Lusignan et participe à une expédition en Tibériade. Impressionné par la valeur des deux frères, Amaury souhaite les attacher à son service et autorise en 1204 le mariage de Guy avec Helvis d'Ibelin, veuve de Renaud de Grenier, comte de Sidon. Avec l'annonce de la fondation de l'empire latin de Constantinople par les croisés, Amaury comprend que l'armée croisée n'arrivera plus, et négocie une trêve de six ans avec le sultan mamelouk Al-Adel. Simon retourne en Europe, tandis que Guy reste exerce la régence du comté de Sidon au nom de son beau-fils Balian de Grenier. Guy et Helvis eurent deux enfants :
- Philippe († 1270), qui lui succèdera à Castres, puis partit à son tour se croiser et deviendra seigneur de Tyr et de Toron.
- Pernelle, nonne à l'abbaye Saint-Antoine des Champs à Paris.
En 1210 prend fin sa régence, Balian ayant probablement atteint sa majorité. Guy assiste au couronnement de Jean de Brienne le 1er octobre 1210, puis revient en Europe et rejoint son frère pour l'aider à mener à bien la croisade des Albigeois. En 1212, il met le siège devant le château de Montségur, mais en vain. Il combat ensuite aux côtés de son frère à la bataille de Muret (1213), au siège de Beaucaire (1216) puis à celui de Toulouse (1218). Il est blessé lors d'une sortie des Toulousains assiégés, et c'est en voulant le secourir que son frère Simon reçoit le roc qui lui sera fatal. La mort de Simon et l'incompétence de son fils Amaury firent que les seigneurs occitans reprennent leurs droits.
Pendant cette période, Guy de Montfort s'était remarié avec Briende de Beynes, veuve de Lambert de Thury, baron de Lambers. Ils eurent :
- Alicie de Montfort, nonne à Port-Royal en 1259
- Agnès de Montfort, nonne à Port-Royal en 1259
- Guy II de Montfort, mort en 1254, baron de Lombers, mort en croisade
En 1224, Amaury cède ses droits sur l'Occitanie au roi Louis VIII le Lion, qui vient ensuite en faire la conquête. Guy participa au siège d'Avignon, qui dura trois mois. La ville se rendit au bout trois mois, mais la maladie força l'armée royale à se replier et le roi mourut sur le chemin du retour, à Montpensier. Guy resta combattre en Occitanie, et fut tué peu après alors qu'il assiégeait Varilhes, près de Pamiers. L'arrière petite fille de Guy de Montfort, Eléonore de Montfort herite du fief à la fin du XIIIs et l'apporte à son mari Jean V de Vendôme et ainsi entre dans cette famille. Pendant la guerre de Cent Ans, le roi d'Angleterre l'attribue à Claude de Beauvoir, le château souffrit en 1428 de l'assaut du terrible Salisbury. Il revient par la suite à la famille des Sanguin et elle fut acquise par les Hurault de Cheverny à la fin 15ème, revendue à la fin 16ème à la famille de l'Hospital-Sainte-Mesme, enfin resta la propriété des Rohan-Rochefort jusqu'à la Révolution. Louis XVI, après avoir chassé en forêt de Rambouillet, aurait pris un bol de lait à Saint-Martin-de-Bréthencourt.
Les armes des Brethencourt - Montfort se blasonnent ainsi : D'azur au lion à la queue fourchée d'argent surmonté d'un lambel de quatre pendants du même.AU CENTRE BLASON MONTFORT-CASTRES.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.Le château fort
1-1) Le site
Cette tour, autrefois barlongue, était dotée de contreforts plats au niveau des angles et sur les faces. Elle constitue le dernier vestige du château construit par Guy le Rouge vers la fin du XIe siècle. Les vestiges révèlent des murs de refend au niveau inférieur, qui comportait donc plusieurs salles. L'enceinte polygonale qui entourait ce donjon, presque tangente en un point, était formée de murailles sans tour de flanquement et bordées d'un fossé.
1-2) La bayle "l'enceinte Nord"
1-3) L'enceinte Haute
L'enceinte entourant le donjon était un polygone irrégulier d'environ 50 x 30m, épaisse de plus d'un mètre, sans tours de flanquement mais munie de corbeaux (échauguettes??).
a) Le mur Ouest
b) Le mur Est
1-4) La motte castrale
1-5) Le donjon roman
Donjon rectangulaire à contreforts plats aux angles et sur les faces (en ruine) de la fin du XIs, situé sur une exploitation agricole ; à l'ouest du donjon, restes d'un mur d'enceinte polygonal. Ce donjon de part sa forme et sa taille est comparable au donjon roman de Chevreuse de la même époque (et du même seigneur). Il a des dimensions d'environ 16,50 x 13,50m et un mur de refend en séparait l'intérieur. On voit à l'intérieur les vestiges d'une console qui prouve qu'une partie du donjon était voûtée. Les murs encore existants sont hauts d'environ 8m pour une épaisseur de 2m.
a) L'extérieur
b) L'intérieur
c) Le mur de refend
1-6) Les fossés
2.Saint Arnoult en Yvelines
2-1) Le site
Ce territoire, primitivement inclus dans le domaine des Carnutes, dépend du castrum d'Hibern (Rochefort) pendant l'occupation romaine. Il est habité dès l'époque mérovingienne par des ermites, et le coteau nord de la vallée de la Renarde sert de nécropole, principalement au lieu-dit Les Chatras. Saint Arnoul, ou Arnoult, mort vers 535, est inhumé en ces lieux, et un premier sanctuaire est érigé à l'emplacement de sa sépulture. En 717, un prieuré est attribué par un diplôme de Chilperic II aux moines de Saint-Maur-des-Fossés. L'endroit étant devenu lieu de pèlerinage, Guy le Rouge, comte de Rochefort, vient s'y recueillir en rentrant de croisade et répand ensuite le culte de saint Arnoult autour de Paris. Son rayonnement parvient jusqu'à Crépy-en-Valois et Clermont pour atteindre Deauville en Normandie. Pilliée et incendiée au cours de la guerre de Cent Ans, en 1498, instauration par Louis XII d'un marché et en 1545, François Ier accorda le titre de cité qui autorisait la ville à s'entourer de fortifications et d'enceinte. La cité, pillée et ravagée au cours des guerres de Religion, retrouva ensuite une nouvelle ère de prospérité. En 1536, sous le règne de François Ier, le prieuré passe sous la juridiction de l'évêché de Paris. Le 30 avril 1702, il est cédé par l'évêque parisien à Charles de Rohan-Rochefort, qui le détient jusqu'à la Révolution. Quant au domaine de Saint-Arnoult, il revient à la mort de Guy le Rouge à son fils, puis aux Garlande, aux Montfort en 1120, aux Roucy en 1317. Il est intégré au patrimoine des Rohan au XVIIIe siècle, comme le prieuré. Parallèlement, les Pontbriand laissent leur empreinte au domaine du Mesnil, qu'ils conservent du XVe, au XVIIe siècle. Saint-Arnoult, situé à 50 kilomètres de Notre-Dame-de-Paris, est une halte de pèlerinage très fréquentée. En 1649, il figure comme « gite » sur l'itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au XVIIIe siècle, la localité est animée par l'activité de huit moulins à tan et à blé sur la rivière, et les caves voûtées font office de celliers et de greniers à grain.
Les armes de Saint-Arnoult-en-Yvelines se blasonnent ainsi : De gueules aux six besant d'or.
2-2) L'enceinte urbaine
a) Le mur d'enceinte
Rare témoin des fortifications de la ville, cette meurtrière (sur une tourelle des remparts) pratiquée dans la muraille est destinée aux mousquets.
b) Les différentes tours
Élément de la porte de l'Isle, autrement dénommée porte au b'uf ou porte de Dourdan, cette ancienne tour (12 bis rue de l'Isle) faisait partie des fortifications élevées à la suite d'une lettre patente de François Ier. La construction des remparts dure de 1546 à 1578. L'ensemble comporte 5 portes, 3 tours d'angle et 4 demi-lunes dans la partie nord, ainsi que 3 tours d'angle et 2 demi-lunes dans la partie sud. Cette portion était doublée d'une sente et d'un fossé devenu « la Morte rivière ».
2-3) La ferme du prieuré "de Saint Maur les Fossés"
Ancien grenier à blé aux portes de la Beauce, Saint-Arnoult possède des caves XIIIs à plusieurs niveaux destinées à entreposer le grain et le vin. Ces caves se situent sous d'anciennes auberges construites le long de la rue. Les ogives chanfreinées partent des gros piliers centraux et retombent sur des culots contre les murs (64, rue Charles de Gaulle). Le colombier XVs (rue des remparts) faisait partie de la ferme du prieuré bénédictin de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Cette bâtisse comporte 500 boulins situés à 1,30 mètre du sol, hors de portée du saut d'un rat.
3.Gauvilliers "Ferme Fortifiée"
3-1) Le site
Au Moyen Age, Orsonville dépend probablement du prieuré de Saint-Martin-des-Champs, fondé à Paris en 1059 par Henri Ier. La ferme fortifiée de Gauvilliers est celle d'un fief du XVe siècle. Cette ferme fortifiée, construite à l'écart du bourg, est représentative des exploitations agricoles liées au régime féodal. Entourée de douves, elle conserve les flèches ou pièces en bascule, du pont-levis, ainsi que la bretèche qui contribuait à la défense du manoir grâce aux mâchicoulis et aux archères dont elle est pourvue. Le pavillon carré à la haute toiture signale l'entrée ; il abritait également le colombier.
3-2) L'enceinte
3-3) Les fossés
3-4) Le chatelet
3-5) Les logis
3-6) Le donjon rectangulaire
4.Clairefontaine en Yvelines"l'Abbaye"
4-1) Le site
Le nom de « Clairefontaine » vient du latin, clara fontana en référence aux sources d'eau limpide de la vallée de la Rabette.
D'après la tradition, sainte Scariberge a choisi le site de Saint-Remy-des-Landes pour se retirer près du tombeau de son époux. Les grands défrichements du Moyen Âge en forêt d'Yvelines permettent l'implantation de deux grandes abbayes vers 1108 : Notre-Dame-de-Clairefontaine et Saint-Remy-des-Landes. En 1160, Simon III de Montfort et l'évêque de Chartres installent sur le territoire un couvent de religieuses bénédictines. De 1179 à la Révolution, 25 abbesses s'y succèdent. Mlle de Richelieu et Mme de Portal en sont les plus célèbres, et cette dernière, après s'être réfugiée pendant la Révolution à l'abbaye de Louye, près de Dourdan, est guillotinée pour avoir correspondu avec la famille de Rohan. Auparavant, la fondation religieuse avait été confiée aux chanoines réguliers de Saint-Augustin. Après une suite de procès au XVIIIe siècle entre les abbés et les chanoines, l'abbaye périclite. Par la suite, les bâtiments sont restaurés et occupés par des religieuses dominicaines. L'église abbatiale a longtemps accueilli les paroissiens. Tandis que les dominicaines continuent de mener une vie contemplative à l'abbaye Notre-Dame-de-Clairefontaine jusqu'à la fin du XXe siècle, l'église paroissiale, propriété de l'association diocésaine, est érigée en 1902. Une partie du mobilier de l'église abbatiale y est transférée. Des bâtiments de l'ancienne abbaye royale, ruinée pendant la Révolution, subsistent le cloitre, le cellier, la crypte, et un escalier monumental.
Abbé de Notre-Dame de Clairefontaine, conseiller et aumônier ordinaire du roi François 1er et abbé de Saint-Martin-de-Troarn, Mathurin de Harville est décédé le 19 juillet 1584. Il est représenté sur la dalle funéraire avec sa mitre, sa crosse et son habit de prélat. L'abbé semble prier les yeux ouverts. Les armes de sa famille sont gravées dans les angles inférieurs.
La pierre tombale de Jeanne Tramblai, morte en 1323, est fixée au mur de l'église à côté de celle de Guy de Rochefort, son mari, représenté en cotte de maille.
4-2) Le château XIXs
Cette villa est construite sur le site de l'abbaye bénédictine détruite pendant la Révolution. Elle est complétée d'une chapelle et d'un grand parc agrémenté de pièces d'eau. Le logis, couvert d'un toit à la Mansart, est une grande bâtisse rectangulaire. L'agencement de l'avant-corps est bien différencié du reste du bâtiment.
5.Index et bibliographie:
- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.
- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.
- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.
- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.
- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.
- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.
- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).
- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.
- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.
- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.
- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.
- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.
- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.
- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.
- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).
- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.
- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.
- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.
- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.
- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.
Rochefort en Yvelines, le magnifique
ROCHEFORT en YVELINES
MAGNIFIQUE FORTERESSE sur DYKE
La région entre Montfort et Rochefort tome I
I Situation géographique :
II Contexte géopolitique et historique :
La commune de Rochefort-en-Yvelines se trouve dans le sud-est des Yvelines, près de la limite de l'Essonne dans la massif forestier de Rambouillet. Elle est à 15 kilomètres environ à l'est de Rambouillet et à 8 kilomètres environs au nord de Dourdan. La commune fait partie du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Le village de Rochefort est situé sur la Butte de la Moque-Bouteille et est entouré par quatre rivières: la Rémarde au sud; la Rabette a l'ouest; L'Aulne au nord et la Gloriette a l'est.
L'Hibernie, « butte de la forêt » ou « abri de population », est le site d'un oppidum romain qui domine la vallée de la Robette, ancienne place forte gauloise avec son oppidum dont les restes d’enceinte encore visibles au niveau des fondations des ruines du château féodal, rappellent la période gallo-romaine. et sa grande décadence vers 406. Il est donc probable que Rochefort existait déjà à cette époque. A l’origine de la monarchie, les rois francs au VIe siècle s’attribuèrent les propriétés conquises. C’est ainsi qu’ils possédèrent la foret d’Yveline qui s’étendait entre autres sur le Parisis, l’Etampais, et le pays chartrain.
Plus tard à l’époque carolingienne, eu lieu le partage de la région en 768 par Pépin Le Bref. La foret d’Yveline fut alors partagée entre plusieurs abbayes et l’hibernie devint l’apanage du domaine royale sous le nom de Rupes Fortis ou de Petraforti dans les textes latins postérieurs. Rochefort était à cette époque l’un des trois centres de population de la région.
Rochefort est resté dans le domaine royal au IXe et fait partie des biens du comte Robert le fort qui le transmis à Hugues le grand puis à Thibaut-fils-étoupes le tricheur grand-père de Gui 1er seigneur de Monthlery. Malgré les fortifications édifiées par Robert le fort, les Normands détruisirent Rochefort en grande partie vers 911.
A la fin du Xe siècle, la royauté était réduite à quelques domaines. Louis VI le gros dut combattre pour dompter les seigneurs. Le comté de Rochefort était une des principales seigneuries des temps féodaux qui grâce à ses nombreux châteaux et vassaux le rendait maître des communications entre Paris et Chartres et Orléans.
Son fils Guy de Montlhéry dit le Rouge en se mariant avec Adelaide (ou Adeline) avant 1063, héritière du domaine de ROCHEFORT devint en 1095 le 1er Comte de Rochefort. Adelaide possédait probablement Rochefort et St Arnoult terres données par le roi ultérieurement. Le comté est délimité au nord par la commune de Bonnelles, au sud par ST Arnoult. Guy le Rouge (en raison de ses cheveux), né après 1040, fils de Guy 1er et de Hodierne de Montlhery (Gometz) fut le serviteur fidèle du roi Henry 1er puis de Philippe 1er, qui l’éleva à la dignité de sénéchal. Il et devint l’un des plus riches seigneurs d’Ile de France, plus puissant que le roi lui même. Il fut Seigneur de Gometz, de la Ferté Beaudoin et de Chateaufort par son père Guy 1er. Il est établi qu’il fit construire le château de Bréthencourt.
Guy le Rouge (en raison de ses cheveux), né après 1040, fils de Guy 1er et de Hodierne de Montlhery (Gometz) fut le serviteur fidèle du roi Henry 1er puis de Philippe 1er, qui l’éleva à la dignité de sénéchal. Il et devint l’un des plus riches seigneurs d’Ile de France, plus puissant que le roi lui même. Il fut Seigneur de Gometz, de la Ferté Beaudoin et de Chateaufort par son père Guy 1er. Il est établi qu’il fit construire le château de Bréthencourt.
Adelaide fonde le prieuré de Bréthencourt et meurt en 1099. Guy le Rouge se remarie avec Elisabeth de Crécy de Montdidier et devient donc en plus Seigneur de Crecy et châtelain de Gournay.
Guy le Rouge participa à la première croisade de 1096 et s’enrôla dans la « Sainte Milice ».et rentra en France en 1104 chargé de gloire et de biens. Il retrouva ses titres de sénéchal et de dapifer.
Il n’est pas complètement démontré mais probable qu’il construisit le château-fort dont certaines ruines restent encore visibles et qui domine la vallée de la Rémarde et celle de la Rabette.
Philippe 1er pour asseoir sa puissance, fiança Louis le gros son fils et successeur à Luciane, la plus jeune fille de Gui, laquelle n’était pas encore nubile. Après la rupture des fiançailles par Philippe, ce qui rompit l’alliance entre Guy et la famille royale, Guy le rouge provoqua la jalousie des petits seigneurs des alentours dont les frères Garlande, qui attaquèrent le château de Montlhéry démantelé par Philippe 1er à l’exception de la tour toujours dressée.
Auparavant Guy voulu céder son poste de sénéchal à son fils Hugues de Crécy mais ce fut en fait Anseau de Garlande qui le récupéra après que les liens d’amitié entre Guy et le roi Louis VI se rompirent. Il mourut probablement en 1108 ou 1109.
Son fils Guy II de Rochefort lui succéda mais il n’avait pas l’aura de son père. Il s’allia avec des ennemis de Louis le gros. Il s’éteignit en 1112 après avoir faillit écraser l’armée royale à Puiset, malheureusement sans postérité.
C’est donc sa sœur Agnès qui lui succéda et gagna tous les biens incluant le comté de Rochefort et la seigneurie de St Arnoult. Elle s’était mariée avec Anseau de Garlande, ennemi des Monthlery et sénéchal de Louis VI le Gros, qui eurent une fille prénommée également Agnès (petite fille de Guy le Rouge) qui épousa Amaury III de Montfort. Là commença le long règne des Montfort.
Les Montfort sont des normands du Vexin dont leur berceau Montfort-l’Amaury sera la capitale de leur seigneurie. Ce qui devrait devenir un Comté, comprenait vers l’an mille 13 prévôtés sur les Yvelines.
On notera qu’une des filles de Amaury épousa Hughes de Crécy, fils de Guy le Rouge.
Le fils de Amaury III, Amaury IV régna de 1137 à 1140 et mourut célibataire après seulement 3 ans de règne.
Son frère Simon III le chauve, lui succéda en 1140 et fut seigneur de Montfort, de Rochefort et de St Arnoult. Il possédait également le Comté d’Evreux et de Leicester en Angleterre. Il fut un adversaire redoutable de la royauté et livra ses forteresses à Henri II d’Angleterre. Il maria son fils Amaury comte d’Evreux à Mabel fille de Robert de Gloucester abandonnant ainsi le Roi de France. Louis VII lui pardonna en 1167. Il meurt en 1171 et son neveu Simon IV, le terrible capitaine de la croisade contre les Albigeois, lui succéda jusqu’en 1218.
Son fils Amaury, connétable de Saint-Louis, en 1238 il partit en terre sainte, prisonnier à Gaza, libéré au bout de 3 ans il mourut à Otrante lors de son retour en France. Son fils Jean 1er meurt après 8 ans de règne en 1249 sans descendance mâle, à Chypre où il fut vénéré comme un bienheureux.
Montfort et Rochefort échurent donc à sa fille Béatrice, épouse de Robert de Dreux, qui mourut en 1312. Son fils et ses deux filles se partagèrent le domaine de Montfort et le comté cédé à Jeanne en 1317. Les trois enfants de Jeanne se partagèrent à nouveau le comté, Jean de Roucy et Marie héritant d’une partie du domaine où se situait Rochefort et St-Arnoult. Au XIVs, le château devint la propriété de Bureau de La Rivière, conseiller de Charles V, puis en 1596, elle échut à Hercule de Rohan, petit-fils de Catherine de Silly, qui fit reconstruire le château. La principauté de Rochefort resta la propriété des Rohan jusqu'à la révolution. La branche de Rochefort, seule subsistante, porte encore le titre de "prince de Rochefort". Le château encore reconstruit au XVIIIs fut alors démoli.
Vers 1853, la mairie s'installe dans le bâtiment du bailliage (où elle se trouve encore actuellement) qui servit autrefois de tribunal et de prison. Il fut légué à la commune en 1831 par la famille Rohan.
Les armes de Rochefort se blasonnent ainsi : coupé, au premier d'or à la croix de gueules cantonnées de quatre alérions d'azur, au second de gueules à neuf macles d'or, à un château d'argent maçonné de sable brochant en abîme sur le tout.
III Plan des lieux :
En cours de réalisation
IV Descriptif du site:
1.Le château fort
1-1) Le site
Anciennement "Petra Forti" à l'époque romaine, au XIs, Guy Ier de Montlhéry, dit Guy le Rouge (premier seigneur de Rochefort et sénéchal de France), fit construire au sommet de la butte un château fort imposant. La seigneurie, dotée du titre de principauté, passa au cours des siècles entre les mains de diverses famille dont les Montfort au XIIs. Le site est abandonné après les guerres de Religion et démoli à l'époque de la Ligue. Eperon gréseux long de plus de 100m, dominant le bourg d'une trentaine de mètres, aménagé en étroite terrasse aux contours tourmentés portant les courtines de la forteresse. Le mur d'enceinte est conservé sur ses faces Est et Sud (présence d'un mur bouclier) de près de 10m de hauteur, épais d'environ 2m et possédant encore par endroit son chemin de ronde.. Au Nord, la présence d'un donjon rectangulaire "roman" est attesté par les vestiges de pierres de parement (site fouillé et abîmé au début du XIXs). Dans la courtine Est, est perçée une poterne piétonne avec assommoir, proche de celle une tour hémicylindrique pleine veille. Un mur d'enceinte au Sud sépare la Bayle de la haute cour, ce mur est percé d'une porte de liaison et d'une poterne principale vers l'Ouest donnant vers la ville (église). Ce mur épais possède son escalier pour accès au chemin de ronde, toujours existant.
Ce château fort, dont les vestiges témoignent de l'importance du pouvoir des seigneurs locaux, a probablement été l'un des plus grands du sud de la région parisienne.
1-2) La bayle
a) L'enceinte
b) Le mur bouclier
c) La poterne vers la haute cour
1-3) L'enceinte Haute
1-4) La tour pleine
1-5) La poterne haute
1-6) La poterne de ville
1-7) Le chemin de ronde
1-8) La chapelle castrale
1-9) Le donjon roman
1-10) Les logis
1-11) Le couloir des latrines
2.Eglise fortifiée Saint Gilles
2-1) Le site
Dès sa construction, l'église sise entre le château perché sur la colline et le village au bord de la Rabette, est dédiée à saint Gilles. Primitivement constituée d'une nef unique, d'un choeur et d'un chevet, puis d'un clocher comprenant une tour carrée avec une absidiole saillante, elle est agrandie par une chapelle latérale dédiée à la Vierge, à laquelle elle doit l'adjonction du vocable de l'Assomption. La chapelle funéraire de la famille Rohan dite « chapelle des Princes », ajoutée ultérieurement, reçoit les sépultures de la famille jusqu'en 1793. Cette église est orientée nord-sud en raison de l'étroitesse de la terrasse.
2-2) L'église
Église saint-Gilles-et-de-l'Assomption : édifice en pierre de style roman des XI et XIIs. Choeur roman appuyé de contreforts et voûté d'ogives, abside flanquée d'une tour massive carrée coiffée en bâtière, absidiole greffée sur cette tour, portail roman surmonté de 2 voussures, la « chapelle des Princes » abrite les sépultures de la famille de Rohan.
2-3) Les fortifications
2-4) Le clocher "donjon roman"
2-5) Le mur terrasse à contreforts
3.L'enceinte Urbaine
3-1) Le site
De l'enceinte urbaine, il reste essentiellement 2 tours (refaites), les vestiges d'une porte et un corps de garde proche de l'église faisant la liaison entre la ville basse et le domaine castral.
3-2) Les tours
3-3) L'enceinte
3-4) La porte de "Paris"
3-5) Le corps de garde ou sergenterie
4.Index et bibliographie: